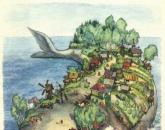Auteur de la théorie de l'avantage comparatif dans le commerce international. Théorie de l'avantage comparatif
Échange international- le système des relations internationales marchandises-argent, formé du commerce extérieur de tous les pays du monde. Le commerce international est né lors de l'émergence du marché mondial aux XVIe et XVIIIe siècles. Son développement est l'un des facteurs importants du développement de l'économie mondiale à l'ère moderne.
Le terme commerce international a été utilisé pour la première fois au XIIe siècle par l'économiste italien Antonio Margaretti, auteur du traité économique Le pouvoir des masses populaires en Italie du Nord.
Avantages de la participation des pays au commerce international :
- l'intensification du processus de reproduction dans les économies nationales est une conséquence d'une spécialisation accrue, de la création d'opportunités pour l'émergence et le développement de la production de masse, une augmentation du degré d'utilisation des équipements, une augmentation de l'efficacité de l'introduction de nouvelles technologies;
- une augmentation de l'offre d'exportation entraîne une augmentation de l'emploi ;
- la concurrence internationale rend nécessaire l'amélioration des entreprises ;
- les recettes d'exportation servent de source d'accumulation de capital pour le développement industriel.
Théories du commerce international
Le développement du commerce mondial repose sur les bénéfices qu'il apporte aux pays qui y participent. La théorie du commerce international donne un aperçu de ce qui est au cœur de ces gains du commerce extérieur, ou de ce qui détermine la direction des flux du commerce extérieur. Le commerce international sert d'outil par lequel les pays, en développant leur spécialisation, peuvent augmenter la productivité des ressources disponibles et ainsi augmenter le volume de biens et services qu'ils produisent, et augmenter le niveau de bien-être de la population.
De nombreux économistes de renom ont traité des questions de commerce international. Les principales théories du commerce international - Théorie mercantiliste, Théorie des avantages absolus d'A. Smith, Théorie Avantages comparatifs D. Ricardo et D. S. Mill., Théorie Heckscher-Ohlin, Leontief Paradox, Théorie cycle de la vie marchandises, la théorie de M. Porter, le théorème de Rybczynski et la théorie de Samuelson et Stolper.
Théorie mercantiliste. Le mercantilisme est un système de vues des économistes des XVe-XVIIe siècles, centré sur l'intervention active de l'État dans activité économique... Représentants de la direction : Thomas Maine, Antoine de Montchretien, William Stafford. Le terme a été inventé par Adam Smith, qui a critiqué les travaux des mercantilistes. La théorie mercantiliste du commerce international est née au cours de la période d'accumulation initiale du capital et de la grande découvertes géographiques, reposait sur l'idée que la présence de réserves d'or est la base de la prospérité d'une nation. Le commerce extérieur, pensaient les mercantilistes, devrait être axé sur l'obtention d'or, car dans le cas d'une simple bourse de marchandises marchandises ordinaires, étant utilisé, cessent d'exister et l'or s'accumule dans le pays et peut être réutilisé pour les échanges internationaux.
Dans ce cas, le trading était considéré comme un jeu à somme nulle, lorsque le gain d'un participant entraîne automatiquement la perte de l'autre, et vice versa. Pour obtenir le maximum d'avantages, il a été proposé de renforcer l'intervention et le contrôle du gouvernement sur l'état du commerce extérieur. La politique commerciale des mercantilistes, appelée protectionnisme, se résumait à créer des barrières au commerce international, à protéger les producteurs nationaux de la concurrence étrangère, à stimuler les exportations et à restreindre les importations en introduisant des droits de douane pour les marchandises étrangères et recevoir de l'or et de l'argent en échange de leurs marchandises.
Les principales dispositions de la théorie mercantiliste du commerce international :
- la nécessité de maintenir une balance commerciale active de l'État (excès des exportations sur les importations) ;
- reconnaissance des avantages d'attirer l'or et d'autres métaux précieux afin d'améliorer son bien-être ;
- la monnaie est une incitation au commerce, puisqu'on croit qu'une augmentation de la masse monétaire augmente le volume de la masse marchande ;
- le protectionnisme visant à importer des matières premières et des produits semi-finis et à exporter des produits finis est le bienvenu;
- restriction à l'exportation de produits de luxe, car elle conduit à la fuite d'or de l'État.
La théorie de l'avantage absolu d'Adam Smith. Dans son étude sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations, Smith, dans une polémique avec des mercantilistes, a formulé l'idée que les pays sont intéressés par le libre développement du commerce international, puisqu'ils peuvent en bénéficier, qu'ils soient exportateurs ou importateurs. Chaque pays devrait se spécialiser dans la production du produit où il a un avantage absolu - un avantage basé sur des coûts de production différents dans les différents pays participant au commerce extérieur. Le refus de la production de biens pour lesquels les pays ne disposent pas d'avantages absolus, et la concentration des ressources sur la production d'autres biens entraînent une augmentation des volumes totaux de production, une augmentation des échanges de produits de leur travail entre les pays.
La théorie de l'avantage absolu d'Adam Smith suggère que la richesse réelle d'un pays consiste en les biens et services disponibles pour ses citoyens. Si un pays peut produire tel ou tel produit plus et moins cher que d'autres pays, alors il a un avantage absolu. Certains pays peuvent produire des biens plus efficacement que d'autres. Les ressources du pays affluent vers les industries rentables, car le pays ne peut pas rivaliser dans les industries non rentables. Cela conduit à une augmentation de la productivité du pays ainsi que des compétences la main d'oeuvre; de longues périodes de production homogène incitent à développer des méthodes de travail plus efficaces.
Avantages naturels pour un pays donné : climat ; territoire; Ressources. Les avantages acquis pour un seul pays : la technologie de production, c'est-à-dire la capacité de fabriquer une variété de produits.
La théorie des avantages comparatifs par D. Ricardo et D. S. Mill. Dans son ouvrage "Les principes d'économie politique et de fiscalité", Ricardo a montré que le principe de l'avantage absolu n'est qu'un cas particulier règle générale, et étayé la théorie de l'avantage comparatif (relatif). Lors de l'analyse des directions de développement du commerce extérieur, deux circonstances doivent être prises en compte : d'une part, les ressources économiques - naturelles, main-d'œuvre, etc. - sont inégalement réparties entre les pays, et d'autre part, la production efficace de divers biens nécessite des technologies ou des combinaisons différentes. de ressources.
Les avantages dont disposent les pays ne sont pas des données une fois pour toutes, a fait valoir Ricardo, de sorte que même les pays ayant des niveaux de coûts de production absolument plus élevés peuvent bénéficier des échanges commerciaux. Il est dans l'intérêt de chaque pays de se spécialiser dans la production, dans laquelle il a le plus grand avantage et le moins de faiblesse, et pour laquelle le profit non absolu, mais relatif est le plus grand - c'est la loi de l'avantage comparatif de D. Ricardo. Selon la version de Ricardo, le volume total de la production sera le plus élevé lorsque chaque produit est fabriqué par le pays dans lequel les coûts d'opportunité (imputés) sont plus faibles. Ainsi, un avantage relatif est un avantage basé sur des coûts d'opportunité (imputés) inférieurs dans le pays exportateur. Par conséquent, en raison de la spécialisation et du commerce, les deux pays participant à l'échange en bénéficieront. Un exemple dans ce cas est l'échange de drap anglais contre du vin portugais, qui profite aux deux pays, même si les coûts de production absolus du drap et du vin sont plus bas au Portugal qu'en Angleterre.
Par la suite, DS Mill dans son ouvrage « Les fondements de l'économie politique » a donné une explication du prix auquel s'effectue l'échange. Selon Mill, le prix d'échange est fixé selon les lois de l'offre et de la demande à un niveau tel que l'ensemble des exportations de chaque pays permet de payer l'ensemble de ses importations - c'est la loi de la valeur internationale.
Théorie de Heckscher-Ohlin. Cette théorie des scientifiques suédois, apparue dans les années 30 du XXe siècle, fait référence aux concepts néoclassiques du commerce international, puisque ces économistes n'adhéraient pas aux théorie du travail valeur, considérant la production, avec le travail, le capital et la terre. Par conséquent, la raison de leur commerce est la fourniture différente de facteurs de production dans les pays participant au commerce international.
Les principales dispositions de leur théorie se résumaient à ce qui suit : premièrement, les pays ont tendance à exporter les biens pour la fabrication desquels sont utilisés les facteurs de production abondants du pays et, à l'inverse, à importer des biens pour la production desquels des facteurs relativement rares sont avait besoin; deuxièmement, il y a une tendance à l'égalisation des « prix des facteurs » dans le commerce international ; troisièmement, l'exportation de marchandises peut être remplacée par le transfert de facteurs de production au-delà des frontières nationales.
Le concept néoclassique de Heckscher-Ohlin s'est avéré commode pour expliquer les raisons du développement des échanges entre pays développés et pays en développement, lorsqu'en échange de matières premières entrant dans les pays développés, des machines et équipements étaient importés dans les pays en développement. Cependant, tous les phénomènes du commerce international ne rentrent pas dans la théorie de Heckscher-Ohlin, puisqu'aujourd'hui le centre de gravité du commerce international se déplace progressivement vers le commerce mutuel de biens "similaires" entre pays "similaires".
Le paradoxe de Léontief. Il s'agit de la recherche d'un économiste américain qui a remis en question les dispositions de la théorie Heckscher-Ohlin et a montré que dans la période d'après-guerre, l'économie américaine s'est spécialisée dans ces types de production qui nécessitaient relativement plus de travail que de capital. L'essence du paradoxe de Léontiev était que la part des biens à forte intensité de capital dans les exportations pouvait augmenter et celle à forte intensité de main-d'œuvre pouvait diminuer. En réalité, lors de l'analyse de la balance commerciale américaine, la part des biens à forte intensité de main-d'œuvre n'a pas diminué. La solution au paradoxe de Léontiev était que l'intensité de main-d'œuvre des biens importés par les États-Unis est assez élevée, mais le prix du travail dans la valeur des marchandises est bien inférieur à celui des exportations des États-Unis. L'intensité capitalistique du travail aux États-Unis est importante, ainsi qu'une productivité du travail élevée, ce qui conduit à une influence significative du prix du travail dans les fournitures d'exportation. La part de l'offre HIMO dans les exportations américaines augmente, confirmant le paradoxe de Leontief. Ceci est dû à une augmentation de la part des services, des prix du travail et de la structure de l'économie américaine. Cela conduit à une augmentation de l'intensité du travail de l'ensemble économie américaine, sans exclure l'exportation.
La théorie du cycle de vie d'un produit. Elle a été avancée et étayée par R. Vernoy, C. Kindelberger et L. Wels. Selon eux, un produit passe par un cycle de cinq étapes depuis son apparition sur le marché jusqu'à sa sortie :
- développement de produits. L'entreprise trouve et met en œuvre nouvelle idée des biens. A cette époque, le volume des ventes est nul, les coûts augmentent.
- apporter des marchandises sur le marché. Il n'y a pas de profit en raison des coûts de marketing élevés, les ventes augmentent lentement ;
- conquête rapide du marché, augmentation des profits;
- maturité. La croissance des ventes ralentit car la plupart des consommateurs ont déjà été attirés. Le niveau de profit reste inchangé ou diminue en raison de l'augmentation des coûts des activités de marketing pour protéger le produit de la concurrence ;
- déclin. Une baisse des ventes et une baisse des bénéfices.
La théorie de M. Porter. Cette théorie introduit le concept de compétitivité d'un pays. C'est la compétitivité nationale, du point de vue de Porter, qui détermine le succès ou l'échec dans des industries spécifiques et la place qu'un pays occupe dans l'économie mondiale. La compétitivité nationale est déterminée par la capacité de l'industrie. L'explication de l'avantage compétitif du pays repose sur le rôle du pays d'origine dans la stimulation du renouvellement et de l'amélioration (c'est-à-dire dans la stimulation de la production d'innovations). Mesures gouvernementales pour maintenir la compétitivité :
- l'influence du gouvernement sur les conditions des facteurs ;
- l'impact du gouvernement sur les conditions de la demande ;
- impact du gouvernement sur les industries connexes et de soutien;
- l'impact du gouvernement sur la stratégie, la structure et la rivalité des entreprises.
Une concurrence suffisante sur le marché intérieur est une incitation sérieuse au succès sur le marché mondial. Domination artificielle des entreprises utilisant soutien de l'État, du point de vue de Porter, est une décision négative qui entraîne un gaspillage et une utilisation inefficace des ressources. Les prémisses théoriques de M. Porter ont servi de base à l'élaboration de recommandations au niveau des États pour améliorer la compétitivité des biens du commerce extérieur en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis dans les années 90 du XXe siècle.
Le théorème de Rybchinsky. Le théorème consiste à affirmer que si la valeur de l'un des deux facteurs de production augmente, alors afin de maintenir des prix constants pour les biens et les facteurs, il est nécessaire d'augmenter la production des produits dans lesquels ce facteur accru est intensivement utilisé , et de réduire la production du reste des produits qui utilisent intensivement un facteur fixe. Pour que les prix des biens restent constants, les prix des facteurs de production doivent être constants. Les prix des facteurs ne peuvent rester constants que si le rapport des facteurs utilisés dans les deux industries reste constant. Dans le cas d'une augmentation d'un facteur, cela ne peut avoir lieu qu'avec une augmentation de la production dans l'industrie dans laquelle ce facteur est intensivement utilisé, et une réduction de la production dans une autre industrie, ce qui conduira à la libération d'un facteur fixe qui deviendra disponible pour une utilisation avec un facteur de croissance dans une industrie en expansion. ...
La théorie de Samuelson et Stolper. Au milieu du XXe siècle. (1948) Les économistes américains P. Samuelson et V. Stolper ont amélioré la théorie de Heckscher-Ohlin, en présentant que dans le cas de l'homogénéité des facteurs de production, l'identité de la technologie, compétition parfaite et la pleine mobilité des marchandises, l'échange international égalise le prix des facteurs de production entre les pays. Les auteurs fondent leur concept sur le modèle Ricardo avec des ajouts de Heckscher et Ohlin et voient le commerce non seulement comme un échange mutuellement bénéfique, mais aussi comme un moyen de réduire l'écart de développement entre les pays.
Développement et structure du commerce international
Le commerce international est une forme d'échange de produits du travail sous forme de biens et de services entre vendeurs et acheteurs de différents pays. Les caractéristiques du commerce international sont le volume du commerce mondial, la structure des exportations et des importations par produit et sa dynamique, ainsi que la structure géographique du commerce international. L'exportation est la vente de marchandises à un acheteur étranger avec leur exportation à l'étranger. Importation - achat de marchandises auprès de vendeurs étrangers avec leur importation de l'étranger.
Le commerce international moderne se développe à un rythme assez élevé. Parmi les principales tendances du développement du commerce international figurent les suivantes :
1. Il y a un développement prédominant du commerce par rapport aux branches de la production matérielle et à l'ensemble de l'économie mondiale. Ainsi, selon certaines estimations, sur la période des années 50 aux années 90, le PIB mondial a été multiplié par 5 environ, et les exportations de marchandises par au moins 11 fois. En conséquence, si en 2000, le PIB mondial était estimé à 30 000 milliards de dollars, alors le volume du commerce international - exportations plus importations - à 12 000 milliards de dollars.
2. Dans la structure du commerce international, la part des produits manufacturés augmente (jusqu'à 75 %), dont plus de 40 % sont des produits d'ingénierie. Seuls 14% sont des carburants et autres matières premières, la part des produits agricoles - environ 9%, des vêtements et textiles - 3%.
3. Parmi les changements dans l'orientation géographique des flux commerciaux internationaux, il y a eu une augmentation du rôle des pays développés et la Chine. Cependant, les pays en développement (principalement en raison de l'émergence de nouveaux pays industriels fortement orientés vers l'exportation) ont réussi à accroître considérablement leur influence dans ce domaine. En 1950, ils ne représentaient que 16 % du commerce mondial, et en 2001, déjà 41,2 %.
Depuis la seconde moitié du 20e siècle, la dynamique inégale du commerce extérieur est devenue apparente. Dans les années 1960, l'Europe occidentale était le principal centre du commerce international. Ses exportations étaient presque 4 fois supérieures à celles des États-Unis. À la fin des années 1980, le Japon a commencé à prendre la tête en termes de compétitivité. Dans la même période, il a été rejoint par les "pays nouvellement industrialisés" d'Asie - Singapour, Hong Kong, Taïwan. Cependant, au milieu des années 90, les États-Unis occupent la première place mondiale en termes de compétitivité. Les exportations de biens et de services dans le monde en 2007, selon l'OMC, s'élevaient à 16 000 milliards. Dollars américains. La part du groupe de biens est de 80% et les services - 20% du commerce total dans le monde.
4. L'orientation la plus importante dans le développement du commerce extérieur est le commerce intra-entreprise au sein des STN. Selon certains rapports, les livraisons internationales intra-entreprise représentent jusqu'à 70 % de tout le commerce mondial, 80 à 90 % des ventes de licences et de brevets. Les STN étant le maillon le plus important de l'économie mondiale, le commerce mondial est en même temps un commerce au sein des STN.
5. Le commerce des services se développe, et de plusieurs manières. Premièrement, il s'agit d'une fourniture transfrontalière, par exemple, Apprentissage à distance... Une autre manière de fournir des services - la consommation à l'étranger - implique le déplacement du consommateur ou le déplacement de sa propriété vers le pays où le service est fourni, par exemple, le service d'un guide en voyage touristique. La troisième voie est une présence commerciale, par exemple l'activité dans le pays d'une banque ou d'un restaurant étranger. Et la quatrième voie est le mouvement des individus qui sont des prestataires de services à l'étranger, par exemple des médecins ou des enseignants. Les pays les plus développés du monde sont les leaders du commerce des services.
Réglementation du commerce international
La régulation du commerce international se subdivise en régulation étatique et régulation par des accords internationaux et la création d'organisations internationales.
Les méthodes de réglementation étatique du commerce international peuvent être divisées en deux groupes : tarifaires et non tarifaires.
1. Les méthodes tarifaires sont réduites à l'utilisation de droits de douane - taxes spéciales perçues sur les produits du commerce international. Les tarifs douaniers sont des frais facturés par l'État pour l'enregistrement des marchandises et autres objets de valeur à l'étranger. Ces frais, appelés droits, sont inclus dans le prix du produit et sont en définitive payés par le consommateur. La fiscalité douanière implique l'utilisation de droits d'importation pour entraver l'importation de marchandises étrangères dans le pays ; les droits d'exportation sont moins couramment utilisés.
Par la forme de calcul, on distingue les droits :
a) ad valorem, qui sont facturés en pourcentage du prix des marchandises ;
b) spécifique, prélevé sous la forme d'une certaine somme d'argent sur le volume, la masse ou l'unité de marchandise.
Les objectifs les plus importants de l'utilisation des droits d'importation sont à la fois la restriction directe des importations et la restriction de la concurrence, y compris la concurrence déloyale. Sa forme extrême est le dumping - vente de marchandises sur le marché étranger à des prix inférieurs à ceux d'un produit identique sur le marché intérieur.
2. Les méthodes non tarifaires sont diverses et représentent un ensemble de restrictions directes et indirectes à l'extérieur activité économiqueà l'aide d'un vaste système de mesures économiques, politiques et administratives. Ceux-ci inclus:
- quotas (contingents) - l'établissement de paramètres quantitatifs à l'intérieur desquels il est possible d'effectuer certaines opérations de commerce extérieur. Dans la pratique, les contingents sont généralement établis sous la forme de listes de marchandises dont la libre importation ou exportation est limitée par un pourcentage du volume ou de la valeur de leur production nationale. Lorsque la quantité ou le montant du contingent est épuisé, l'exportation (l'importation) du produit correspondant est terminée ;
- licences - la délivrance de permis spéciaux (licences) à des entités commerciales pour mener des opérations de commerce extérieur. Il est souvent utilisé en conjonction avec des quotas pour contrôler les quotas basés sur les licences. Dans certains cas, le système de licences agit comme une forme de taxation douanière appliquée par un pays pour générer des recettes douanières supplémentaires;
- embargo - une interdiction des opérations d'import-export. Il peut s'appliquer à un certain groupe de produits ou être introduit en relation avec des pays individuels ;
- le contrôle des devises est une restriction dans la sphère monétaire. Par exemple, un contingent financier peut limiter la quantité de devises qu'un exportateur peut recevoir. Des restrictions quantitatives peuvent s'appliquer au volume des investissements étrangers, au montant des devises étrangères exportées par les citoyens à l'étranger, etc. ;
- taxes sur les opérations d'import-export - taxes en tant que mesures non tarifaires qui ne sont pas réglementées par des accords internationaux, comme les droits de douane, et sont donc perçues à la fois sur les produits nationaux et étrangers. Des subventions de l'Etat pour les exportateurs sont également possibles ;
- mesures administratives, qui sont principalement liées à des restrictions sur la qualité des marchandises vendues pour marché intérieur... Une place importante est occupée par normes nationales... Le non-respect des normes du pays peut servir de prétexte à l'interdiction d'importer des produits importés et de leur vente sur le marché intérieur. De même, le système des tarifs de transport nationaux crée souvent un avantage en rémunérant le transport des marchandises aux exportateurs par rapport aux importateurs. Par ailleurs, d'autres formes de restrictions indirectes peuvent également être utilisées : la fermeture de certains ports et gares aux étrangers, l'ordre d'utiliser une certaine part des matières premières nationales dans la fabrication des produits, l'interdiction d'acheter organisations gouvernementales marchandises importées en présence d'homologues nationaux, etc.
La grande importance de la MT pour le développement de l'économie mondiale a conduit à la création par la communauté mondiale d'organisations internationales spéciales de réglementation, dont les efforts visent à développer des règles, des principes, des procédures pour la mise en œuvre des normes internationales. accords commerciaux et le contrôle de leur mise en œuvre par les États membres de ces organisations.
Un rôle particulier dans la régulation du commerce international est joué par les accords multilatéraux opérant dans le cadre de :
- GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce);
- OMC ();
- AGCS (Accord général sur le commerce des services);
- ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce);
GATT. Conformément aux dispositions fondamentales du GATT, les échanges entre pays doivent être effectués sur la base du principe de la nation la plus favorisée (NPF), c'est-à-dire que le régime de la nation la plus favorisée (NPF) est établi dans le commerce des pays membres du GATT, qui garantit l'égalité et la non-discrimination. Cependant, dans le même temps, des exceptions au NSP ont été établies pour les pays appartenant à des groupes d'intégration économique ; pour les pays anciennes colonies qui sont en lien traditionnel avec les anciennes métropoles ; pour le commerce frontalier et côtier. Selon les estimations les plus approximatives, la part des « exceptions » représente au moins 60 % du commerce mondial. produits finis, ce qui prive PNB de sa polyvalence.
Le GATT reconnaît les tarifs douaniers comme le seul moyen acceptable de réglementer le MT, qui sont réduits de manière itérative (de tournée en tournée). À l'heure actuelle, leur niveau moyen est de 3-5%. Mais même ici, il existe des exceptions qui permettent l'utilisation de moyens de protection non tarifaires (contingents, licences d'exportation et d'importation, incitations fiscales). Il s'agit notamment de cas d'application de programmes de régulation de la production agricole, de violations de la balance des paiements, de mise en œuvre de programmes de développement régional et d'assistance.
Le GATT contient le principe de s'abstenir d'actions unilatérales et de prendre des décisions en faveur de négociations et de consultations, si de telles actions (décisions) peuvent conduire à une restriction de la liberté du commerce.
Le GATT - le prédécesseur de l'OMC - a pris ses décisions lors des cycles de négociations de tous les membres de cet accord. Ils étaient huit. Les décisions les plus importantes par lesquelles l'OMC a guidé la réglementation du TM jusqu'à présent ont été prises lors du dernier (huitième) cycle d'Uruguay (1986-1994). Ce cycle a encore élargi l'éventail des questions réglementées par l'OMC. Il comprenait le commerce des services, ainsi qu'un programme visant à réduire la valeur des droits de douane, à intensifier les efforts pour réglementer le MT avec les produits de certains secteurs (y compris l'agriculture) et à renforcer le contrôle sur les domaines de la politique économique nationale qui affectent le commerce extérieur du pays.
Il a été décidé d'augmenter les droits de douane à mesure que le degré de transformation des marchandises augmente, tandis que les droits sur les matières premières sont réduits et leur suppression pour certains types boissons alcoolisées, matériel de construction et agricole, mobilier de bureau, jouets, produits pharmaceutiques- seulement 40 % des importations mondiales. La libéralisation du commerce des vêtements, des textiles et des produits agricoles s'est poursuivie. Mais le dernier et le seul moyen de régulation sont les droits de douane.
Dans le domaine des mesures antidumping, les notions de "subventions légales" et de "subventions acceptables" ont été adoptées, qui incluent les subventions visant à protéger environnement et développement régionalà condition que leur taille soit d'au moins 3% de la valeur totale des importations de marchandises ou 1% de celle-ci coût total... Tous les autres sont classés comme illégaux et leur utilisation dans le commerce extérieur est interdite.
Parmi les questions de réglementation économique qui affectent indirectement le commerce extérieur, le Cycle d'Uruguay a inclus les prescriptions relatives à l'exportation minimale des marchandises produites par la coentreprise, l'utilisation obligatoire de composants locaux et un certain nombre d'autres.
OMC... L'Uruguay Round a décidé de créer l'OMC, qui est devenue le successeur légal du GATT et a conservé ses principales dispositions. Mais les décisions du cycle les ont complétées par la mission d'assurer la liberté du commerce non seulement par la libéralisation, mais aussi par l'utilisation de ce qu'on appelle des liens. La signification des liens est que toute décision de l'État d'augmenter le tarif est prise simultanément (en conjonction avec) la décision de libéraliser les importations d'autres biens. L'OMC n'est pas du ressort de l'ONU. Cela lui permet de poursuivre sa propre politique indépendante et de contrôler les activités des pays participants pour se conformer aux accords adoptés.
AGCS. La réglementation du commerce international des services diffère d'une certaine manière. Cela est dû au fait que des services différant par une extrême variété de formes et de contenus ne forment pas un marché unique qui aurait des caractéristiques communes. Mais il a des tendances générales qui permettent de le réguler au niveau mondial, prenant même en compte les nouveaux moments de son développement, qui sont introduits par les STN qui le dominent et le monopolisent. Actuellement, le marché mondial des services est réglementé à quatre niveaux : international (global), sectoriel (global), régional et national.
La régulation générale au niveau mondial s'effectue dans le cadre de l'AGCS, entré en vigueur le 1er janvier 1995. Sa régulation reprend les mêmes règles qui ont été développées par le GATT en matière de marchandises : non-discrimination, traitement national, transparence (ouverture et unité de lecture des lois), non-application des lois nationales au détriment des fabricants étrangers. Cependant, la mise en œuvre de ces règles est entravée par les particularités des services en tant que produit : l'absence de la forme matérielle de la plupart d'entre eux, la coïncidence du temps de production et de consommation des services. Ce dernier signifie que la réglementation des termes de l'échange des services signifie la réglementation des conditions de leur production, et cela, à son tour, signifie la réglementation des conditions d'investissement dans leur production.
L'AGCS comprend trois parties : un accord-cadre qui définit principes généraux et les règles régissant le commerce des services; des accords spéciaux acceptables pour les industries de services individuelles et une liste des engagements des gouvernements nationaux à éliminer les restrictions dans les industries de services. Ainsi, un seul niveau régional sort du champ d'activité de l'AGCS.
L'Accord AGCS vise à libéraliser le commerce des services et couvre les types de services suivants : services dans le domaine des télécommunications, de la finance et des transports. Les questions de ventes à l'export de films et de programmes télévisés sont exclues de son champ d'activité, ce qui est associé aux craintes de certains États (pays européens) de perdre l'originalité de leur culture nationale.
La régulation sectorielle du commerce international des services s'exerce également dans à l'échelle mondiale, qui est associée à leur production et consommation mondiales. Contrairement à l'AGCS, les organisations réglementant ces services sont de nature spécialisée. Par exemple, le transport aérien civil est réglementé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le tourisme étranger est réglementé par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), expédition- Organisation Maritime Internationale (OMI).
Le niveau régional du commerce international des services est réglementé dans le cadre de groupements d'intégration économique, dans lesquels les restrictions sur le commerce mutuel des services sont supprimées (comme, par exemple, dans l'UE) et des restrictions sur ce commerce avec les pays tiers peuvent être introduites.
Le niveau national de réglementation concerne le commerce extérieur des services des différents États. Il est mis en œuvre par le biais d'accords commerciaux bilatéraux, partie de qui peut être le commerce des services. Une place importante dans de tels accords est accordée à la réglementation des investissements dans le secteur des services.
Une source - Économie mondiale: tutoriel / EG Guzhva, MI Lesnaya, AV Kondrat'ev, AN Egorov; SPbGASU. - SPb., 2009 .-- 116 p.
Théories de l'avantage comparatif. La théorie de l'avantage absolu. La théorie du commerce international de Heckscher-Olin. La théorie du commerce international de Léontief. Théories alternatives du commerce international.
Théories du commerce international
Théories des avantages comparatifs
Le commerce international est l'échange de biens et de services grâce auquel les pays répondent à leurs besoins illimités sur la base du développement de la division sociale du travail.
Les principales théories du commerce international ont été élaborées à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. les éminents économistes Adam Smith et David Ricardo. A. Smith dans son livre "Research on the Nature and Causes of the Wealth of Nations" (1776) a formulé la théorie de l'avantage absolu et, argumentant avec les mercantilistes, a montré que les pays sont intéressés par le libre développement du commerce international, puisqu'ils peuvent en bénéficier, qu'ils soient exportateurs ou importateurs. D. Ricardo dans son ouvrage "Les principes d'économie politique et de fiscalité" (1817) a prouvé que le principe d'avantage n'est qu'un cas particulier de la règle générale, et a étayé la théorie de l'avantage comparatif.
Lors de l'analyse des théories du commerce extérieur, deux circonstances doivent être prises en compte. Premièrement, les ressources économiques - matérielles, naturelles, travail, etc. - sont inégalement réparties entre les pays. Deuxièmement, la production efficace de différents biens nécessite différentes technologies ou combinaisons de ressources. Il est important de souligner, cependant, que l'efficacité économique avec laquelle les pays sont capables de produire différents biens peut changer et change effectivement avec le temps. En d'autres termes, les avantages, à la fois absolus et comparatifs, dont bénéficient les pays ne sont pas des données une fois pour toutes.
La théorie de l'avantage absolu.
L'essence de la théorie de l'avantage absolu est la suivante : si un pays peut produire tel ou tel produit plus et moins cher que les autres pays, alors il a un avantage absolu.
Prenons un exemple classique : deux pays produisent deux biens (céréales et sucre).
Supposons qu'un pays ait un avantage absolu en céréales et un autre en sucre. Ces avantages absolus peuvent, d'une part, être générés par des facteurs naturels - des conditions climatiques particulières ou la présence d'énormes ressources naturelles. Les bienfaits naturels jouent un rôle particulier dans agriculture et dans les industries extractives. D'autre part, les avantages dans la production de divers produits (principalement dans les industries manufacturières) dépendent des conditions de production qui prévalent : technologie, qualifications des travailleurs, organisation de la production, etc.
Dans des conditions où il n'y a pas de commerce extérieur, chaque pays ne peut consommer que ces biens et la quantité d'entre eux qu'il produit, et les prix relatifs de ces biens sur le marché sont déterminés par les coûts nationaux de leur production.
Les prix intérieurs pour les mêmes marchandises en différents pays ah sont toujours différents en raison des particularités de l'offre de facteurs de production, des technologies utilisées, des qualifications de la main-d'œuvre, etc.
Pour que le commerce soit mutuellement avantageux, le prix d'un produit sur le marché étranger doit être supérieur au prix intérieur du même produit dans le pays exportateur et inférieur à celui du pays importateur.
Le bénéfice que les pays retireront du commerce extérieur consistera en une augmentation de la consommation, qui peut être due à la spécialisation de la production.
Ainsi, selon la théorie de l'avantage absolu, chaque pays devrait se spécialiser dans la production du produit pour lequel il a un avantage exclusif (absolu).
La loi de l'avantage comparatif. En 1817, D. Ricardo a prouvé que la spécialisation internationale est bénéfique pour la nation. C'était la théorie de l'avantage comparatif, ou, comme on l'appelle parfois, la théorie du coût de production comparatif. Considérons cette théorie plus en détail.
Ricardo n'a pris que deux pays pour simplifier. Appelons-les l'Amérique et l'Europe. Aussi, pour simplifier les choses, il n'a pris en compte que deux biens. Appelons-les nourriture et vêtements. Pour simplifier, tous les coûts de production sont mesurés en temps de travail.
On devrait probablement convenir que le commerce entre l'Amérique et l'Europe devrait être mutuellement bénéfique. Il faut moins de jours de travail pour produire une unité alimentaire en Amérique qu'en Europe, tandis qu'une unité de vêtements en Europe prend moins de jours de travail qu'en Amérique. Il est clair que dans ce cas, l'Amérique, apparemment, se spécialisera dans la production alimentaire et, en exportant une partie, recevra en retour un prêt-à-porter exporté par l'Europe.
Cependant, Ricardo ne s'est pas arrêté là. Il a montré que l'avantage comparatif dépend du ratio de la productivité du travail.
Basé sur la théorie de l'avantage absolu, le commerce extérieur reste toujours bénéfique pour les deux parties. Tant qu'il subsistera des différences dans les rapports des prix intérieurs entre les pays, chaque pays aura un avantage comparatif, c'est-à-dire qu'il aura toujours une marchandise dont la production est plus rentable au rapport des coûts existant que la production des autres. Le gain de la vente des produits sera le plus important lorsque chaque produit est fabriqué par le pays dans lequel le coût d'opportunité est plus faible.
La comparaison des situations d'avantage absolu et comparatif conduit à une conclusion importante : dans les deux cas, les gains du commerce proviennent du fait que les ratios de coûts sont différents selon les pays, c'est-à-dire les directions des échanges sont déterminées par les coûts relatifs, qu'un pays ait ou non un avantage absolu dans la production d'un produit. Il résulte de cette conclusion qu'un pays maximise son gain du commerce extérieur s'il se spécialise entièrement dans la production d'un produit pour lequel il a un avantage comparatif. En réalité, une telle spécialisation complète ne se produit pas, ce qui s'explique notamment par le fait que les coûts de remplacement ont tendance à augmenter avec la croissance des volumes de production. Face à l'augmentation des coûts de substitution, les facteurs déterminant l'orientation des échanges sont les mêmes qu'avec des coûts constants (constants). Les deux pays peuvent bénéficier du commerce extérieur s'ils se spécialisent dans la production de ces biens pour lesquels ils ont un avantage comparatif. Mais avec l'augmentation des coûts, d'une part, la spécialisation complète n'est pas rentable et, d'autre part, en raison de la concurrence entre les pays, les coûts marginaux de remplacement sont nivelés.
Il s'ensuit qu'à mesure que la production alimentaire et vestimentaire augmente et se spécialise, un point sera atteint où le ratio des coûts dans les deux pays se stabilisera.
Dans cette situation, les motifs d'approfondissement de la spécialisation et d'expansion des échanges - différences dans le rapport des coûts - s'épuisent et une spécialisation plus poussée sera économiquement inopportune.
Ainsi, la maximisation des gains du commerce extérieur se produit avec une spécialisation partielle.
L'essence de la théorie de l'avantage comparatif est la suivante : si chaque pays se spécialise dans les produits dans la production desquels il a la plus grande efficacité relative, ou des coûts relativement inférieurs, alors le commerce sera mutuellement bénéfique pour les deux pays grâce à l'utilisation de ressources productives. facteurs augmenteront dans les deux cas.
Le principe de l'avantage comparatif, lorsqu'il est étendu à n'importe quel nombre de pays et n'importe quel nombre de biens, peut avoir des implications universelles.
Un inconvénient sérieux du principe de l'avantage comparatif est sa nature statique. Cette théorie ignore toute fluctuation des prix et les salaires, il fait abstraction de tout écart inflationniste et déflationniste dans les stades intermédiaires, de toutes sortes de problèmes de balance des paiements. Il part de l'hypothèse que si les travailleurs quittent une industrie, ils ne deviennent pas des chômeurs chroniques, mais vont certainement passer à une autre industrie plus productive. Sans surprise, cette théorie abstraite s'est gravement compromise pendant la Grande Dépression. Il y a quelque temps, son prestige a recommencé à se rétablir. V économie mixte fondée sur la théorie de la synthèse néoclassique, mobilisant les théories modernes de la récession chronique et de l'inflation, la théorie classique de l'avantage comparatif regagne en importance sociale.
La théorie de l'avantage comparatif est une théorie cohérente et logique. Malgré toute sa simplification excessive, il est très important. Une nation qui ignore le principe de l'avantage comparatif peut en payer le prix fort : une baisse du niveau de vie et un ralentissement de la croissance économique potentielle.
La théorie du commerce international de Heckscher-Olin
La théorie de l'avantage comparatif laisse de côté la question clé : qu'est-ce qui cause les différences de coûts entre les pays ? L'économiste suédois E. Heckscher et son étudiant B. Olin ont tenté de répondre à cette question. Selon eux, les différences de coûts entre les pays sont principalement dues au fait que les dotations relatives des pays en facteurs de production sont différentes.
Selon la théorie de Heckscher-Olin, les pays s'efforceront d'exporter des facteurs excédentaires et d'importer des facteurs de production rares, compensant ainsi l'approvisionnement relativement faible des pays en facteurs de production à l'échelle de l'économie mondiale.
Il faut souligner que nous ne parlons pas du nombre de facteurs de production dont disposent les pays, mais de leur offre relative (par exemple, de la quantité de terres cultivables par travailleur). Si, dans un pays donné, un facteur de production est relativement plus important que dans d'autres pays, alors son prix sera relativement plus bas. Par conséquent, le prix relatif du produit, dans la production duquel ce facteur bon marché est utilisé dans une plus large mesure que d'autres, sera plus bas »que dans d'autres pays. Ainsi apparaissent des avantages comparatifs qui déterminent l'orientation du commerce extérieur.
La théorie de Heckscher-Ohlin explique avec succès bon nombre des modèles observés dans le commerce international. En effet, les pays exportent principalement des produits dont les coûts sont dominés par leurs ressources relativement excédentaires. Cependant, la structure des ressources productives dont disposent les pays industrialisés se stabilise progressivement. Sur le marché mondial, la part des échanges de marchandises "similaires" entre pays "similaires" augmente.
La théorie du commerce international de Léontief
Le célèbre économiste américain Vasily Leontiev au milieu des années 50. a tenté de tester empiriquement les principales conclusions de la théorie de Heckscher-Ohlin et est parvenu à des conclusions paradoxales. En utilisant le modèle entrées-sorties de la balance entrées-sorties, construit sur la base de données sur l'économie américaine pour 1947, V. Leontyev a prouvé que les biens à forte intensité de main-d'œuvre prévalaient dans les exportations américaines et les biens à forte intensité de capital dans les importations. Ce résultat obtenu empiriquement contredit ce qui a été proposé par la théorie de Heckscher-Ohlin, et a donc été appelé le « paradoxe de Leontief ». Des études ultérieures ont confirmé la présence de ce paradoxe dans l'après-guerre non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour d'autres pays (Japon, Inde, etc.).
De nombreuses tentatives pour expliquer ce paradoxe ont permis de développer et d'enrichir la théorie de Heckscher-Ohlin en prenant en compte des circonstances supplémentaires affectant la spécialisation internationale, parmi lesquelles on peut noter :
hétérogénéité des facteurs de production, principalement la main-d'œuvre, qui peut varier considérablement en termes de niveau de qualification. De ce point de vue, les exportations des pays industrialisés peuvent refléter un excédent relatif de main-d'œuvre hautement qualifiée et de spécialistes, tandis que les pays en développement exportent des produits qui nécessitent des dépenses importantes en main-d'œuvre non qualifiée ;
politique de commerce extérieur de l'État, qui peut restreindre les importations et stimuler la production à l'intérieur du pays et l'exportation des produits des industries où des facteurs de production relativement rares sont utilisés de manière intensive.
Théories alternatives du commerce international
Au cours des dernières décennies, des changements importants ont eu lieu dans les orientations et la structure du commerce mondial, qui ne se prêtent pas toujours à une explication exhaustive dans le cadre des théories commerciales classiques. Cela demande comment la poursuite du développement théories déjà existantes et au développement de concepts théoriques alternatifs. Les raisons sont les suivantes : 1) la transformation du progrès technique en un facteur dominant du commerce mondial, 2) la part toujours croissante dans le commerce des contre-livraisons de biens industriels similaires produits dans des pays ayant à peu près la même offre de facteurs de production, et 3) une forte augmentation de la part du chiffre d'affaires mondial représentée par le commerce intra-firme. Considérez des théories alternatives.
L'essence de la théorie du cycle de vie du produit est la suivante : le développement du commerce mondial produits finis dépend des étapes de leur vie, c'est-à-dire de la période pendant laquelle le produit est viable sur le marché et garantit la réalisation des objectifs du vendeur.
Le cycle de vie d'un produit comprend quatre étapes : adoption, croissance, maturité et déclin. La première étape est le développement de nouveaux produits en réponse à la demande émergente dans le pays. Par conséquent, la production d'un nouveau produit est de nature artisanale, nécessite des travailleurs hautement qualifiés et est concentrée dans le pays d'innovation (généralement un pays industrialisé), et le fabricant occupe une position presque monopolistique et seulement une petite partie du produit va sur le marché extérieur.
Au cours de la phase de croissance, la demande d'un produit augmente et sa production s'étend et s'étend progressivement à d'autres pays développés, le produit devient plus standardisé, la concurrence entre les fabricants augmente et les exportations se développent.
Le stade de maturité se caractérise par une production à grande échelle, le facteur prix devient prépondérant dans la concurrence, et à mesure que les marchés s'étendent et que les technologies se répandent, le pays de l'innovation n'a plus d'avantages compétitifs. La fabrication commence à se déplacer vers les pays en développement où une main-d'œuvre bon marché peut être utilisée efficacement dans des processus de fabrication standardisés.
À mesure que le cycle de vie d'un produit diminue, la demande, en particulier dans les pays développés, diminue, les marchés de production et de vente se concentrent principalement dans les pays en développement et le pays de l'innovation devient un importateur fréquent.
La théorie du cycle de vie des produits reflète de manière assez réaliste l'évolution de nombreuses industries, mais elle n'est pas une explication universelle des tendances de développement du commerce international. Si la recherche et le développement, la technologie de pointe cessent d'être le principal facteur déterminant les avantages concurrentiels, alors la production d'un produit se déplacera effectivement vers des pays qui ont un avantage comparatif dans d'autres facteurs de production, par exemple en termes de main-d'œuvre bon marché. Cependant, il existe de nombreux produits (avec un cycle de vie court, des coûts de transport élevés, d'importantes opportunités de différenciation de qualité, une gamme étroite de consommateurs potentiels etc.) qui ne rentrent pas dans la théorie du cycle de vie.
Théorie des économies d'échelle. Au début des années 80. P. Krugman, K. Lancaster et quelques autres économistes ont proposé une alternative à l'explication classique du commerce international, basée sur ce que l'on appelle l'effet d'échelle.
L'essence de la théorie de l'effet est qu'avec une certaine technologie et organisation de la production, les coûts moyens à long terme diminuent à mesure que le volume de la production augmente, c'est-à-dire qu'il y a une économie due à la production de masse.
Selon cette théorie, de nombreux pays (en particulier les pays industrialisés) disposent des principaux facteurs de production dans des proportions similaires et, dans ces conditions, il leur sera profitable de commercer entre eux en se spécialisant dans les industries caractérisées par la présence de l'effet de la production de masse. Dans ce cas, la spécialisation permet d'étendre la production et de fabriquer un produit à moindre coût et donc à moindre prix. Pour que cet effet de production de masse se réalise, il faut un marché suffisamment grand. Le commerce international y joue un rôle déterminant, car il permet d'élargir les marchés de vente. En d'autres termes, il permet la formation d'un marché intégré unique, plus vaste que le marché d'un seul pays. En conséquence, plus de produits sont offerts aux consommateurs et à des prix inférieurs.
Dans le même temps, la réalisation d'économies d'échelle conduit généralement à une violation de la concurrence parfaite, car elle est associée à la concentration de la production et à la consolidation des entreprises, qui deviennent des monopoles. La structure des marchés évolue en conséquence. Ils deviennent soit des marchés oligopolistiques avec une prédominance d'échanges intersectoriels de produits homogènes, soit des marchés de concurrence monopolistique avec des échanges intra-industriels développés de produits différenciés. Dans ce cas, le commerce international est de plus en plus concentré entre les mains de firmes internationales géantes, sociétés transnationales, qui conduit inévitablement à une augmentation du volume des échanges intra-firme, dont les orientations sont souvent déterminées non par le principe des avantages comparatifs ou des différences dans l'approvisionnement en facteurs de production, mais objectifs stratégiques l'entreprise elle-même.
Bibliographie
Pour la préparation de ce travail ont été utilisés des matériaux du site matfak.
Mercantiliste théorie développée et mise en œuvre dans XVI-XVIII siècles, est le premier de théories du commerce international.
Les partisans de cette théorie pensaient que le pays devait restreindre les importations et essayer de tout produire par lui-même, ainsi que de toutes les manières possibles pour encourager l'exportation de produits finis, en recherchant un afflux de devises (or), c'est-à-dire que seule l'exportation était considérée comme économiquement justifiée. En raison de la balance commerciale positive, le flux d'or dans le pays a augmenté les opportunités d'accumulation de capital et a ainsi contribué à croissance économique, l'emploi et la prospérité du pays.
Les mercantilistes n'ont pas tenu compte des avantages que les pays reçoivent au cours de division internationale main-d'œuvre provenant de l'importation de biens et de services étrangers.
Selon la théorie classique du commerce international souligne que « l'échange est favorable aux chaque pays; chaque pays y trouve un avantage absolu ", la nécessité et l'importance du commerce extérieur sont prouvées.
Pour la première fois, la politique de libre-échange a été définie A. Smith.
D. Ricardo a développé les idées d'A. Smith et a soutenu qu'il est dans l'intérêt de chaque pays de se spécialiser dans la production dans laquelle le bénéfice relatif est le plus grand, où il a le plus grand avantage ou le moins de faiblesse.
Le raisonnement de Ricardo a trouvé son expression dans théorie de l'avantage comparatif(coûts de production comparatifs). D. Ricardo a prouvé que les échanges internationaux sont possibles et souhaitables dans l'intérêt de tous les pays.
J.S. Mill ont montré que, selon la loi de l'offre et de la demande, le prix d'échange est fixé à un niveau tel que l'ensemble des exportations de chaque pays permet de couvrir l'ensemble de ses importations.
Selon Les théories de Heckscher-Ohlin les pays chercheront toujours à exporter secrètement des facteurs de production excédentaires et à importer des facteurs de production rares. C'est-à-dire que tous les pays ont tendance à exporter des biens qui nécessitent des intrants importants de facteurs de production, dont ils disposent en abondance relative. Par conséquent le paradoxe de Léontief.
Le paradoxe est qu'en utilisant le théorème de Heckscher-Ohlin, Leontiev a montré que l'économie américaine de l'après-guerre s'est spécialisée dans ces types de production qui nécessitaient relativement plus de travail que de capital.
Théorie de l'avantage comparatif a été développé en tenant compte des éléments suivants circonstances affectant la spécialisation internationale :
- hétérogénéité des facteurs de production, principalement la main-d'œuvre, différant par le niveau de qualification ;
- le rôle des ressources naturelles qui ne peuvent être utilisées dans la production qu'en conjonction avec de grandes quantités de capital (par exemple, dans les industries extractives) ;
- influence sur la spécialisation internationale des politiques de commerce extérieur des États.
L'État peut restreindre les importations et stimuler la production à l'intérieur du pays et l'exportation des produits des industries où ils sont intensivement utilisés relativement facteurs de production rares.
La théorie de l'avantage concurrentiel de Michael Porter
En 1991, l'économiste américain Michael Porter a publié une étude "Avantages compétitifs des pays", publiée en russe sous le titre " Compétition internationale« En 1993. Dans cette étude, une approche complètement nouvelle des problèmes du commerce international a été élaborée de manière suffisamment détaillée. L'un des prérequis à cette approche est le suivant : Les entreprises, et non les pays, sont en concurrence sur le marché international. Pour comprendre le rôle du pays dans ce processus, il est nécessaire de comprendre comment une entreprise individuelle crée et maintient un avantage concurrentiel.
Le succès sur le marché étranger dépend d'une stratégie concurrentielle correctement choisie. La concurrence implique des changements constants dans l'industrie, ce qui affecte considérablement les paramètres sociaux et macroéconomiques du pays d'origine, c'est pourquoi l'État joue un rôle important dans ce processus.
Selon M, Porter, la principale unité de concurrence est l'industrie, c'est-à-dire un groupe de concurrents qui produisent des biens et fournissent des services et qui se font directement concurrence. Une industrie fabrique des produits avec des sources similaires d'avantage concurrentiel, bien que les frontières entre les industries soient toujours assez vagues. Choisir la stratégie concurrentielle de l'entreprise il y a deux facteurs principaux dans l'industrie.
1. Structures de l'industrie, dans lequel l'entreprise opère, c'est-à-dire caractéristiques de la concurrence. La concurrence dans une industrie est influencée par cinq facteurs :
1) l'émergence de nouveaux concurrents ;
2) l'émergence de biens ou services de substitution ;
3) la capacité des fournisseurs à négocier ;
4) la capacité des acheteurs à négocier ;
5) la rivalité des concurrents existants entre eux.
Ces cinq facteurs déterminent la rentabilité d'une industrie car ils affectent les taux de mousse fixés par les entreprises, leurs coûts, leurs dépenses en capital, etc.
À mesure que de nouveaux concurrents entrent dans l'industrie, le potentiel de rentabilité globale de l'industrie diminue à mesure qu'ils apportent de nouvelles capacités de fabrication dans l'industrie et cherchent des parts de marché, et à mesure que des produits ou services de substitution apparaissent, le prix qu'une entreprise peut facturer pour son produit est limité.
Les fournisseurs et les acheteurs, lors de la négociation, en retirent des avantages, ce qui peut entraîner une diminution des bénéfices de l'entreprise -
Le prix à payer pour la compétitivité lors de la concurrence avec d'autres entreprises est soit des coûts supplémentaires, soit une baisse de prix, et par conséquent, une diminution des bénéfices.
L'importance de chacun des cinq facteurs est déterminée par ses principaux aspects techniques et caractéristiques économiques... Par exemple, la capacité des acheteurs à négocier dépend du nombre d'acheteurs de l'entreprise, de la part des ventes qui incombe à un acheteur, du fait que le prix d'un produit représente une partie importante des coûts totaux de l'acheteur et de la menace de nouveaux concurrents. sur la difficulté pour un nouveau concurrent de « pénétrer » dans l'industrie. ...
2. La position que l'entreprise occupe dans l'industrie.
La position d'une entreprise dans l'industrie est principalement déterminée par avantage compétitif. Une entreprise est en avance sur ses concurrents si elle dispose d'un avantage concurrentiel stable :
1) des coûts inférieurs, indiquant la capacité de l'entreprise à développer, produire et vendre un produit comparable à un coût inférieur à celui de ses concurrents. En vendant un produit au même ou approximativement au même prix que ses concurrents, l'entreprise réalise dans ce cas un gros profit.
2) différenciation des biens, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins de l'acheteur, en proposant des biens ou plus Haute qualité, ou avec des propriétés spéciales pour les consommateurs, ou avec des capacités étendues de service après-vente.
L'avantage concurrentiel vous donne une productivité plus élevée que la concurrence. Autres facteur important qui influence la position d'une entreprise dans une industrie est l'étendue de la concurrence, ou l'étendue des objectifs que l'entreprise cible dans son industrie.
Concurrence ne signifie pas équilibre, mais changement constant. Chaque industrie est constamment améliorée et mise à jour. De plus, le pays d'origine joue un rôle important dans la stimulation de ce processus. Pays natal - c'est un pays où la stratégie, les produits de base et la technologie sont développés et une main-d'œuvre avec les compétences nécessaires est disponible.
M. Porter identifie quatre propriétés d'un pays qui forment l'environnement dans lequel les entreprises locales se font concurrence et qui influencent son succès international (figure 4.6.). Le modèle dynamique de formation des avantages compétitifs de l'industrie peut être représenté sous la forme d'un diamant national.
Graphique 4.6. Déterminants de l'avantage concurrentiel d'un pays
Les pays ont plus de chances de réussir dans les secteurs où les composants du diamant national se renforcent mutuellement.
Ces déterminants, chacun individuellement et tous ensemble en tant que système, créent l'environnement dans lequel les entreprises d'un pays donné naissent et opèrent.
Les pays réussissent dans certaines industries du fait que l'environnement dans ces pays se développe de manière plus dynamique et, en posant constamment des défis aux entreprises, les fait mieux utiliser les avantages concurrentiels existants.
L'avantage sur chaque déterminant n'est pas une condition préalable à l'avantage concurrentiel dans une industrie. C'est l'interaction des avantages à travers tous les déterminants qui fournit des points gagnants auto-renforçants qui ne sont pas disponibles pour les concurrents étrangers.
Chaque pays possède, à un degré ou à un autre, les facteurs de production nécessaires aux activités des entreprises de toute industrie. La théorie de l'avantage comparatif dans le modèle Heckscher-Ohlin est consacrée à la comparaison des facteurs disponibles. Le pays exporte des marchandises, dans la production desquelles divers facteurs sont intensivement utilisés. Cependant, des facteurs. en règle générale, ils ne sont pas seulement hérités, mais aussi créés, par conséquent, pour obtenir et développer des avantages concurrentiels, ce n'est pas tant le stock de facteurs à l'heure actuelle qui est important, mais la vitesse de leur création. De plus, une abondance de facteurs peut miner un avantage concurrentiel, et leur absence peut induire un renouvellement, ce qui peut conduire à un avantage concurrentiel à long terme. Dans le même temps, la dotation en facteurs est assez importante, c'est donc le premier paramètre de cette composante du "diamant".
Dotation en facteurs
Traditionnellement, la littérature économique distingue trois facteurs : le travail, la terre et le capital. Mais leur influence se reflète désormais plus pleinement dans une classification légèrement différente :
· Les ressources humaines, qui se caractérisent par le nombre, les qualifications et le coût de la main-d'œuvre, ainsi que par la durée des heures normales de travail et l'éthique du travail.
Ces ressources sont divisées en de nombreuses catégories, puisque chaque industrie requiert une liste spécifique de catégories spécifiques de travailleurs;
· Les ressources physiques, qui sont déterminées par la quantité, la qualité, la disponibilité et le coût des terres, de l'eau, des minéraux, des ressources forestières, des sources d'électricité, etc. Celles-ci peuvent également inclure les conditions climatiques, la situation géographique et même le fuseau horaire ;
· Une ressource de connaissances, c'est-à-dire un ensemble d'informations scientifiques, techniques et commerciales qui affectent les biens et services. Ce stock est concentré dans les universités, les organismes de recherche, les banques de données, la littérature, etc. ;
· Les ressources monétaires, caractérisées par le montant et la valeur du capital pouvant être utilisé pour financer l'industrie ;
Infrastructure, y compris le système de transport, le système de communication, les services postaux, le transfert de paiements entre banques, le système de santé, etc.
La combinaison des facteurs appliqués diffère d'un secteur à l'autre. Les entreprises obtiennent un avantage concurrentiel lorsqu'elles disposent de facteurs bon marché ou de haute qualité qui sont importants pour concurrencer dans un secteur particulier. Ainsi, l'emplacement de Singapour sur une importante route commerciale entre le Japon et le Moyen-Orient en a fait le centre de l'industrie de la réparation navale. Cependant, l'obtention d'un avantage concurrentiel basé sur les facteurs ne dépend pas tant de leur disponibilité que de leur utilisation effective, car les EMN peuvent fournir les facteurs manquants en achetant ou en localisant des activités à l'étranger, et de nombreux facteurs se déplacent relativement simplement d'un pays à l'autre.
Les facteurs sont divisés en basiques et développés, généraux et spécialisés. Les principaux facteurs sont les ressources naturelles, les conditions climatiques, la situation géographique, la main-d'œuvre non qualifiée, etc. Ils sont reçus par le pays par héritage ou avec peu d'investissement. Ils ont peu d'importance pour l'avantage concurrentiel d'un pays, ou l'avantage qu'ils créent n'est pas durable. Le rôle des principaux facteurs diminue en raison d'une diminution de leur besoin ou en raison de leur disponibilité accrue (y compris à la suite de transferts d'activités ou d'achats à l'étranger). Ces facteurs sont importants dans les industries extractives et v industries liées à l'agriculture. Les facteurs développés comprennent des infrastructures modernes, une main-d'œuvre hautement qualifiée, etc.
Théories du commerce international
Ce sont ces facteurs qui sont les plus importants, car ils vous permettent d'obtenir un plus haut niveau d'avantage concurrentiel.
Selon le degré de spécialisation, les facteurs sont divisés en facteurs généraux, qui peuvent être appliqués dans de nombreuses industries, et en facteurs spécialisés. Les facteurs spécialisés constituent une base plus solide et durable pour un avantage concurrentiel que les facteurs génériques.
Les critères de répartition des facteurs en fondamentaux et développés, généraux et spécialisés doivent être considérés en dynamique, car ils évoluent dans le temps.Les facteurs diffèrent selon qu'ils sont nés de manière lyonique ou créés artificiellement. Tous les facteurs contribuant à l'obtention d'un plus haut niveau d'avantage concurrentiel sont artificiels. Les pays réussissent dans les secteurs où ils sont le mieux à même de créer et d'améliorer les facteurs nécessaires.
Conditions de demande (paramètres)
Le deuxième déterminant de l'avantage concurrentiel national est la demande sur le marché intérieur de biens ou de services offerts par cette industrie. Influençant les économies d'échelle, la demande sur le marché intérieur détermine la nature et la vitesse de l'innovation. Elle se caractérise par : la structure, le volume et la nature de la croissance, l'internationalisation.
Les entreprises peuvent obtenir un avantage concurrentiel compte tenu des caractéristiques clés suivantes de la structure de la demande :
· Une part importante de la demande intérieure tombe sur des segments de marché mondiaux ;
Les acheteurs (y compris les intermédiaires) sont pointilleux et exigeants, ce qui oblige les entreprises à relever les normes de qualité de production, de service et propriétés de consommation des biens;
· Le besoin dans le pays d'origine survient plus tôt que dans d'autres pays ;
· Le volume et la nature de la croissance de la demande intérieure permettent aux entreprises d'acquérir un avantage concurrentiel s'il existe une demande à l'étranger pour un produit très demandé sur le marché intérieur, et s'il existe également un grand nombre d'acheteurs indépendants, ce qui crée un environnement plus favorable au renouvellement ;
· La demande intérieure croît rapidement, ce qui stimule l'intensification des investissements en capital et la vitesse de renouvellement ;
· Le marché intérieur est rapidement saturé, en conséquence, la concurrence devient plus rude, dans laquelle les plus forts survivent, ce qui les oblige à entrer sur le marché extérieur.
L'impact des paramètres de la demande sur la compétitivité dépend également d'autres parties du diamant. Ainsi, sans une forte concurrence, un marché intérieur large ou sa croissance rapide ne stimule pas toujours l'investissement. Sans le soutien des industries concernées, les entreprises sont incapables de répondre aux besoins des acheteurs exigeants, etc.
Industries connexes et de soutien
Le troisième déterminant qui détermine l'avantage concurrentiel national est la présence dans le pays d'industries fournisseurs ou d'industries connexes qui sont compétitives sur le marché mondial,
En présence d'industries fournisseurs compétitives, les actions suivantes sont possibles :
· Accès efficace et rapide à des ressources coûteuses, telles que des équipements ou de la main-d'œuvre qualifiée, etc. ;
· Coordination des fournisseurs sur le marché intérieur;
· Accompagnement du processus d'innovation. Les entreprises nationales bénéficient le plus lorsque leurs fournisseurs sont compétitifs sur le marché mondial.
La présence dans le pays d'industries connexes compétitives conduit souvent à l'émergence de nouveaux types de production très développés. En rapport fait référence aux industries dans lesquelles les entreprises peuvent interagir les unes avec les autres pour former une chaîne de valeur, ainsi qu'aux industries qui traitent des produits complémentaires tels que les ordinateurs et les logiciels. L'interaction peut avoir lieu dans le domaine du développement technologique, de la production, du marketing, du service. Si un pays a des industries connexes qui peuvent rivaliser sur le marché mondial, l'accès à l'échange d'informations et à l'interaction technique s'ouvre. La proximité géographique et les affinités culturelles conduisent à des échanges plus actifs qu'avec les entreprises étrangères.
Le succès sur le marché myronien d'une industrie peut entraîner le développement de la production de biens et services supplémentaires. Cependant, le succès des fournisseurs et des industries connexes ne peut affecter le succès des entreprises nationales que si le reste du diamant est affecté positivement.
CONFÉRENCES SUR LE COURS "ÉCONOMIE MONDIALE".FROLOVA T.A.
Thème 1 : THÉORIE DU COMMERCE INTERNATIONAL 2
1. La théorie de l'avantage comparatif 2
2. Théories néoclassiques 3
3. Théorie de Heckscher-Ohlin 3
4. Paradoxe de Léontief 4
5. Théories alternatives du commerce international 4
Thème 2. MARCHÉ MONDIAL 6
1. L'essence de l'économie mondiale 6
2. Les étapes de la formation de l'économie mondiale 6
3. La structure du marché mondial 7
4. Concurrence sur le marché mondial 8
5. La réglementation gouvernementale commerce mondial 9
Sujet 3. SYSTÈME MONÉTAIRE MONDIAL 10
1. Étapes de développement du système monétaire mondial 10
2. Taux de change et convertibilité des devises 12
3. Régulation étatique du taux de change 14
4. Balance des paiements 15
Thème 4 : INTÉGRATION ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE 17
1. Formes d'intégration économique 17
2. Formes de mouvement de capitaux 17
3. Conséquences de l'exportation et de l'importation de capitaux 18
4. Migration de travail 20
5. Réglementation étatique de la migration de main-d'œuvre 21
Thème 5. MONDIALISATION ET PROBLÈMES DE L'ÉCONOMIE MONDIALE 22
1 Mondialisation : l'entité et les défis qu'elle crée 22
3. Organisations économiques internationales 23
Thème 6. ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES (ZES) 25
1.Classification de la FEZ 25
3. Avantages et phases du cycle de vie de la ZES 26
Thème 1 : THÉORIE DU COMMERCE INTERNATIONAL
1. La théorie de l'avantage comparatif
La théorie du commerce international a traversé un certain nombre d'étapes dans son développement avec le développement de la pensée économique. Cependant, leurs principales questions étaient et restent les suivantes : qu'est-ce qui est au cœur de la division internationale du travail ? Quelle spécialisation internationale est la plus efficace pour les pays ?
Les fondements de la théorie du commerce international ont été posés à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Les économistes anglais Adam Smith et David Ricardo. Smith dans son ouvrage "Recherches sur la nature et les causes de la richesse des peuples" a montré que les pays s'intéressent au libre développement du commerce international, car peuvent en bénéficier, qu'ils soient exportateurs ou importateurs. Il a créé la théorie de l'avantage absolu.
Ricardo, dans son ouvrage "Principles of Political Economy and Taxation", a prouvé que le principe de l'avantage absolu n'est qu'un cas particulier de la règle générale, et a étayé la théorie de l'avantage comparatif.
Un pays a un avantage absolu s'il existe un produit qui, par unité de coût, peut produire plus qu'un autre pays.
Ces avantages peuvent, d'une part, être générés par des facteurs naturels - conditions climatiques particulières, disponibilité des ressources naturelles. Les avantages naturels jouent un rôle particulier dans l'agriculture et les industries extractives.
D'autre part, des avantages peuvent être acquis, c'est-à-dire grâce au développement de la technologie, à l'amélioration des qualifications des travailleurs, à l'amélioration de l'organisation de la production.
En l'absence de commerce extérieur, chaque pays ne peut consommer que ces biens et uniquement la quantité qu'il produit.
Les prix relatifs des biens sur le marché intérieur sont déterminés par les coûts relatifs de leur production. Les prix relatifs d'un même produit fabriqué dans différents pays sont différents. Si cette différence dépasse le coût de transport des marchandises, alors il y a une opportunité de profiter du commerce extérieur.
Pour que le commerce soit mutuellement avantageux, le prix d'un produit sur le marché étranger doit être supérieur au prix intérieur du pays exportateur et inférieur à celui du pays importateur.
Théories fondamentales du commerce international
Le bénéfice que les pays retireront du commerce extérieur consistera en une augmentation de la consommation, qui peut être due à 2 raisons :
changements dans les modes de consommation;
spécialisation de la production.
Tant qu'il subsistera des différences dans les ratios des prix intérieurs entre les pays, chaque pays aura avantage comparatif, c'est à dire. elle aura toujours une marchandise dont la production est plus rentable au rapport actuel des coûts que la production des autres.
Le volume total de la production sera le plus élevé lorsque chaque produit est fabriqué par le pays dans lequel les coûts d'opportunité sont plus faibles. Les directions du commerce mondial sont déterminées par les coûts relatifs.
2. Théories néoclassiques
Les économistes occidentaux contemporains ont développé la théorie des coûts comparatifs de Ricardo. Le plus connu est le modèle des coûts d'opportunité, dont l'auteur est l'économiste américain G. Haberler.
Le modèle de l'économie de 2 pays est considéré, dans lequel 2 biens sont produits. Les courbes sont supposées pour chaque pays capacités de production... La meilleure technologie et toutes les ressources sont considérées comme utilisées. Pour déterminer l'avantage comparatif de chaque pays, la base est le volume de production d'un bien, qui doit être réduit afin d'augmenter la production d'un autre bien.
Ce modèle de division du travail est dit néoclassique. Mais il repose sur un certain nombre de simplifications. Il provient de la présence de :
seulement 2 pays et 2 produits ;
libre échange;
mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur du pays et immobilité (pas de débordement) par pays;
coûts de production fixes;
manque de frais de transport;
aucune modification technique ;
interchangeabilité complète des ressources dans leur utilisation alternative.
3. Théorie de Heckscher-Ohlin
Dans les années 30. Les économistes suédois du XXe siècle Eli Heckscher et Bertel Olin ont créé leur propre modèle de commerce international. A cette époque, de grands changements s'étaient produits dans le système de la division internationale du travail et du commerce international. Le rôle des différences naturelles comme facteur de spécialisation internationale a sensiblement diminué et les biens industriels ont commencé à prédominer dans les exportations des pays développés. Le modèle Heckscher-Ohlin vise à expliquer les raisons du commerce international des produits manufacturés.
dans la production de divers biens, les facteurs sont utilisés dans des proportions différentes ;
la dotation relative des pays en facteurs de production n'est pas la même.
D'où la loi de proportionnalité des facteurs : dans une économie ouverte, chaque pays tend à se spécialiser dans la production d'une marchandise qui nécessite plus de facteurs, dont le pays est relativement mieux doté.
L'échange international est l'échange de facteurs abondants contre des facteurs rares.
Ainsi, les facteurs excédentaires sont exportés sous une forme cachée et les facteurs de production rares sont importés, c'est-à-dire la circulation des marchandises d'un pays à l'autre compense la faible mobilité des facteurs de production à l'échelle de l'économie mondiale.
Dans le processus du commerce international, les prix des facteurs de production sont égalisés. Dans un premier temps, le prix d'un facteur en excès sera relativement bas. L'excédent de capital conduit à une spécialisation dans la production de biens à forte intensité de capital, le flux de capitaux vers les industries d'exportation. La demande de capital augmente donc le prix du capital augmente.
S'il y a une abondance de main-d'œuvre dans le pays, alors les biens à forte intensité de main-d'œuvre sont exportés. Le prix du travail (salaires) augmente également.
4. Le paradoxe de Léontief
Vasily Leontyev a étudié à Berlin après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Leningrad. En 1931, il émigre aux États-Unis et commence à enseigner à l'Université Harvard. En 1948, il est nommé directeur du Service de recherche économique. a développé une méthode analyse économique Entrée-sortie (utilisée pour la prévision). En 1973, il a reçu le prix Nobel.
En 1947, Leontiev a tenté de tester empiriquement les conclusions de la théorie de Heckscher-Ohlin et est parvenu à des conclusions paradoxales. En examinant la structure des exportations et des importations américaines, il a constaté que les biens à forte intensité de main-d'œuvre prédominaient dans les exportations américaines et que les biens à forte intensité de capital prédominaient dans les importations.
Considérant que dans les années d'après-guerre aux États-Unis, le capital était un facteur de production relativement excédentaire et que le niveau des salaires était nettement plus élevé que dans d'autres pays, ce résultat contredisait la théorie de Heckscher-Ohlin et était donc appelé le paradoxe de Leontief.
Leontiev a émis l'hypothèse que dans n'importe quelle combinaison avec un montant donné de capital, 1 année-homme de travail américain équivaut à 3 années-homme de travail étranger. Il a suggéré qu'une productivité plus élevée du travail américain est associée à des niveaux de compétence plus élevés chez les travailleurs américains. Leontyev a effectué un test statistique, qui a montré que les États-Unis exportent des marchandises qui nécessitent une main-d'œuvre plus qualifiée que les importations.
Cette étude a servi de base à la création par l'économiste américain D. Keesing en 1956, d'un modèle qui prend en compte les qualifications de la main-d'œuvre. Il y a 3 facteurs impliqués dans la production : le capital, la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Une relative abondance de main-d'œuvre hautement qualifiée conduit à l'exportation de biens nécessitant de grandes quantités de main-d'œuvre qualifiée.
Les modèles ultérieurs des économistes occidentaux ont utilisé 5 facteurs : capital financier, la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, les terres propices à la production agricole et d'autres ressources naturelles.
5. Théories alternatives du commerce international
Au cours des dernières décennies du 20e siècle, des changements importants ont eu lieu dans les directions et la structure du commerce international, qui ne sont pas toujours expliqués par la théorie classique de la TA. Parmi ces glissements qualitatifs, il faut noter la transformation du progrès scientifique et technologique en un facteur dominant du commerce international, une proportion croissante de contre-livraisons de biens industriels similaires. Il est devenu nécessaire de prendre en compte cette influence dans les théories du commerce international.
Théorie du cycle de vie du produit.
Au milieu des années 60. L'économiste américain du XXe siècle R. Vernon a avancé la théorie du cycle de vie d'un produit, dans laquelle il a tenté d'expliquer le développement du commerce mondial des produits finis sur la base des étapes de leur vie.
L'étape de la vie est la période pendant laquelle un produit est viable sur le marché et garantit que les objectifs du vendeur sont atteints.
Le cycle de vie d'un produit comprend 4 étapes :
Mise en œuvre. A ce stade, un nouveau produit est développé en réponse à un besoin émergent dans le pays. La production est de nature artisanale, nécessite des travailleurs hautement qualifiés et est concentrée dans le pays de l'innovation. Le fabricant a une position presque monopolistique. Seule une petite partie du produit est destinée au marché extérieur.
Croissance. La demande pour le produit augmente, sa production s'étend et s'étend à d'autres pays développés. Le produit se standardise. La concurrence s'intensifie, les exportations se développent.
Maturité. Cette étape est caractérisée par une production à grande échelle, le facteur prix prévaut sur la concurrence. Le pays de l'innovation n'a plus d'avantages compétitifs. La production commence à se déplacer vers les pays en développement où la main-d'œuvre est moins chère.
Déclin. Dans les pays développés, la production est en baisse, les marchés de vente sont concentrés dans les pays en développement. Le pays de l'innovation devient un importateur net.
Théorie des économies d'échelle.
Au début des années 80. XX siècle P. Krugman et K. Lancaster ont proposé une explication alternative du commerce international, basée sur les économies d'échelle. L'essence de l'effet est qu'avec une certaine technologie et organisation de la production, les coûts moyens à long terme diminuent à mesure que le volume de production augmente, c'est-à-dire les économies d'échelle découlent de la production de masse.
Selon cette théorie, de nombreux pays disposent des principaux facteurs de production dans des proportions similaires et il leur sera donc rentable de commercer entre eux en se spécialisant dans des industries caractérisées par la présence de l'effet de la production de masse. La spécialisation vous permet d'augmenter les volumes de production, de réduire les coûts et les prix. Pour que les économies d'échelle soient réalisées, un grand marché est nécessaire, c'est-à-dire monde.
Modèle d'écart technologique.
Les partisans de la tendance néotechnologique ont tenté d'expliquer la structure du commerce international par des facteurs technologiques. Les principaux avantages sont liés à la position de monopole de l'entreprise innovatrice. Une nouvelle stratégie optimale pour les entreprises : produire non pas ce qui est relativement moins cher, mais ce dont tout le monde a besoin, mais que personne ne peut encore produire. Dès que d'autres pourront maîtriser cette technologie - pour produire quelque chose de nouveau.
L'attitude envers l'État a également changé. Selon le modèle Heckscher-Ohlin, le travail du gouvernement n'est pas d'interférer avec les entreprises. Les économistes néo-tech pensent que l'État devrait soutenir la production de biens d'exportation de haute technologie et ne pas interférer avec la réduction des industries obsolètes.
Le modèle le plus populaire est le modèle d'écart technologique. Ses fondements ont été posés en 1961 dans les travaux de l'économiste anglais M. Posner. Plus tard, le modèle a été développé dans les travaux de R. Vernon, R. Findlay, E. Mansfield.
Le commerce entre les pays peut être causé par changement technologique survenant dans n'importe quelle industrie dans l'un des pays commerçants. Le pays acquiert un avantage comparatif : les nouvelles technologies permettent de produire des biens à faible coût. Si créé Nouveau produit, alors l'entreprise innovante a un quasi-monopole pendant un certain temps, c'est-à-dire obtient un bénéfice supplémentaire.
Du fait des innovations techniques, un fossé technologique s'est formé entre les pays. Cet écart sera progressivement comblé au fur et à mesure que d'autres pays commenceront à copier l'innovation du pays innovateur. Posner, pour expliquer le commerce international constamment existant, introduit le concept de "flux d'innovation", qui apparaît au fil du temps dans différentes industries et différents pays.
Les deux pays commerçants bénéficient de l'innovation. Comme il se propage nouvelle technologie le pays moins développé continue de gagner, tandis que le pays plus développé perd ses avantages. Ainsi, le commerce international existe même lorsque les pays sont également dotés en facteurs de production.
Pages : suivant →
123456Voir tout
ThéoriesinternationalCommerce (7)
Résumé >> Économie
… Autres ressources naturelles. ( CONFÉRENCES Leontyeva V.E.) L'essence de la finance ... domaines, tels que théorieinternationalCommerce, théorie monopole, économétrie. L'attitude de L. ... augmente à notre époque. Moderneéconomie, représentant une ouverture ...
ThéoriesinternationalCommerce (4)
Résumé >> Économie
... cette question dans son " Conférences ", ce sont ces arguments qui ont poussé les classiques ... une partie du classique théorieinternationalCommerce et la plupart moderne les interprétations expliquent le sens de l'externe Commerce, bénéfices économiques ...
Le principal théorieinternationalCommerce (4)
Résumé >> Théorie économique
... Oline, théorie M. Porter et le paradoxe de V. Leontiev. Sujet d'étude - internationalCommerce... V moderne conditions... En 1748. commencé à lire en public conférences sur la littérature et le droit naturel... La même année en conférences dans un certain nombre de leurs principaux ...
Les bases internationalCommerce (2)
Cours >> Théorie économique
... et sur le plan pratique. Les bases modernethéorieinternationalCommerce ont été posées au XIXe siècle. les classiques de l'anglais ... Yablokova, S.А. Économie mondiale [Texte] : Synopsis conférences/ S.A. Iablokova. - M. : PRIOR, 2007 .-- 160 p. - ISBN...
Le principal théorieinternationalCommerce (2)
Guide d'étude >> Économie
... E. Yu. InternationalCommerce: Bien conférences. – … internationalCommerce... Le sujet de recherche est théorieinternationalCommerce. ThéorieinternationalCommerce Heckscher-Ohlin. Théorie l'avantage comparatif explique les directions internationalCommerce …
Je veux plus d'œuvres similaires ...
Les théories modernes de l'économie mondiale
⇐ PrécédentPage 3 sur 7Suivant ⇒
La théorie des économies d'échelle de Krugman et Lancaster a été créé dans les années 80 du XXe siècle. Cette théorie fournit une explication des causes modernes du commerce mondial en termes d'économie de l'entreprise. Les auteurs pensent que l'avantage maximal se trouve dans les industries où la production est effectuée en grandes quantités, car dans ce cas, il y a un effet d'échelle.
Les origines de la théorie des économies d'échelle remontent à A. Marshall, qui a relevé les principales raisons des avantages d'un groupe d'entreprises par rapport à une entreprise individuelle. M. Camp et P. Krugman ont apporté la plus grande contribution à la théorie moderne des économies d'échelle. Cette théorie explique qu'il y ait des échanges entre des pays également dotés en facteurs de production. Les producteurs de ces pays conviennent entre eux qu'un pays reçoit à la fois son propre marché et le marché d'un voisin pour le libre-échange de tout produit spécifique, mais en retour donne à un autre pays un segment de marché pour un autre produit. Et puis les producteurs des deux pays obtiennent des marchés pour eux-mêmes avec une plus grande capacité d'absorption des marchandises. Et leurs clients sont des produits moins chers. Car avec la croissance des volumes de marché, des économies d'échelle commencent à s'opérer, ce qui ressemble à ceci : à mesure que l'échelle de production augmente, le coût de production de chaque unité de production diminue.
Pourquoi? Parce que les coûts de production n'augmentent pas au même rythme que les volumes de production. La raison en est la suivante. Cette partie des coûts, dite "fixe", n'augmente pas du tout, et cette partie, dite "variable", croît à un rythme inférieur au volume de production. Parce que le composant principal de coûts variables la production est le coût des matières premières. Et lors de l'achat en plus gros volumes, le prix par unité de marchandise diminue. Comme vous le savez, plus le lot est "en gros", plus le prix d'achat est avantageux.
De nombreux pays disposent des principaux facteurs de production dans des proportions similaires et il leur sera donc profitable de commercer entre eux en se spécialisant dans des industries caractérisées par la présence de l'effet de la production de masse. La spécialisation vous permet d'augmenter les volumes de production, de réduire les coûts et les prix.
Pour que les économies d'échelle soient réalisées, le plus grand marché possible est nécessaire, c'est-à-dire monde. Et puis il s'avère que pour augmenter le volume de leur marché, des pays à capacités égales s'engagent à ne pas se concurrencer pour les mêmes produits sur les mêmes marchés [ce qui conduit les producteurs à des revenus plus faibles]. Au contraire, pour élargir leurs opportunités de vente les unes pour les autres, en offrant un libre accès à leurs marchés aux entreprises des pays partenaires, en SPÉCIALISANT CHAQUE PAYS SUR DES MARCHANDISES « PROPRES ».
Il devient rentable pour les pays de se spécialiser et d'échanger même des produits technologiquement homogènes mais différenciés (ce que l'on appelle le commerce intra-industriel).
![]() Vorsicht L'effet d'échelle s'observe jusqu'à une certaine limite de croissance de cette même échelle. A un moment donné, l'augmentation progressive des coûts de gestion devient exorbitante et « ronge » la rentabilité de l'entreprise par son accroissement de taille. Parce que de plus en plus grandes entreprises deviennent de plus en plus difficiles à contrôler.
Vorsicht L'effet d'échelle s'observe jusqu'à une certaine limite de croissance de cette même échelle. A un moment donné, l'augmentation progressive des coûts de gestion devient exorbitante et « ronge » la rentabilité de l'entreprise par son accroissement de taille. Parce que de plus en plus grandes entreprises deviennent de plus en plus difficiles à contrôler.
La théorie du cycle de vie d'un produit. Cette théorie appliquée pour expliquer la spécialisation des pays dans l'économie mondiale est apparue dans les années 60 du XXe siècle. L'auteur de cette théorie, Vernon, expliqué le commerce mondial d'un point de vue marketing.
Le fait est qu'un produit en cours d'existence sur le marché passe par plusieurs étapes : création, maturité, baisse de production et disparition. Selon cette théorie, les pays industrialisés se spécialisent dans la production de biens technologiquement nouveaux et les pays en développement - dans la production de biens obsolètes, car la création de nouveaux biens nécessite des capitaux importants, des spécialistes hautement qualifiés et une science développée dans ce domaine. Tout cela est disponible dans les pays industrialisés.
Selon les observations de Vernon, aux stades de création, de croissance et de maturité, la production de biens est concentrée dans les pays industrialisés, puisque pendant cette période, le produit donne le maximum de profit. Mais avec le temps, le produit devient obsolète et entre dans une phase de « déclin » ou de stabilisation. Ceci est facilité par le fait que des biens apparaissent - concurrents d'autres entreprises, distrayant la demande. À la suite de tout cela, les prix et les bénéfices chutent.
La production de biens obsolètes est maintenant transférée vers des pays plus pauvres, où, d'une part, elle redeviendra une nouveauté et, d'autre part, sa production dans ces pays sera moins chère. Au même stade d'obsolescence d'un produit, une entreprise peut vendre une licence pour fabriquer son produit à un pays en développement.
La théorie du cycle de vie d'un produit n'est pas une explication universelle des tendances de développement du commerce international. Il existe de nombreux produits à cycle de vie court, à coûts de transport élevés, à cercle restreint de consommateurs potentiels, etc., qui ne rentrent pas dans la théorie du cycle de vie.
Mais plus important encore, depuis longtemps, les entreprises mondiales localisent la production à la fois de produits de base et de produits obsolètes dans les mêmes pays en développement.
Échange international
Une autre chose est que si le produit est neuf et cher, il est vendu principalement dans les pays riches, et à mesure qu'il devient obsolète, il passe dans les pays plus pauvres. Et dans cette partie de sa théorie, Vernon est toujours d'actualité.
La théorie des avantages compétitifs de M. Porter. Une autre théorie importante expliquant la spécialisation des pays dans l'économie mondiale est La théorie des avantages compétitifs de M. Porter... L'auteur y examine la spécialisation des pays dans le commerce mondial du point de vue de leurs avantages compétitifs. Selon M. Porter, pour réussir sur le marché mondial, il est nécessaire de combiner la stratégie concurrentielle correctement choisie des entreprises avec les avantages concurrentiels du pays.
Points forts du porteur quatre signes d'avantage concurrentiel:
⇐ Précédent1234567Suivant ⇒
© 2015 arhivinfo.ru Tous les droits appartiennent aux auteurs des documents publiés.
Il repose sur les avantages qu'il apporte aux pays participants. La théorie du commerce international donne un aperçu de ce qui est au cœur de ces gains du commerce extérieur, ou de ce qui détermine la direction des flux du commerce extérieur. Le commerce international sert d'outil par lequel les pays, en développant leur spécialisation, peuvent augmenter la productivité des ressources disponibles et ainsi augmenter le volume de biens et services qu'ils produisent, et augmenter le niveau de bien-être de la population.
De nombreux économistes de renom ont traité des questions de commerce international. Les principales théories du commerce international - La théorie mercantiliste, la théorie des avantages absolus d'A. Smith, la théorie des avantages comparatifs de D. Ricardo et D. S. Mill. et aussi La théorie de Samuelson et Stolper.
Théorie mercantiliste.
Le mercantilisme est un système de vues des économistes des XVe-XVIIe siècles, centré sur l'intervention active de l'État dans l'activité économique. Représentants de la direction : Thomas Maine, Antoine de Montchretien, William Stafford. Le terme a été inventé par Adam Smith, qui a critiqué les travaux des mercantilistes. La théorie mercantiliste du commerce international est née pendant la période d'accumulation initiale du capital et des grandes découvertes géographiques, basée sur l'idée que la présence de réserves d'or est la base de la prospérité d'une nation. Le commerce extérieur, pensaient les mercantilistes, devrait être axé sur l'obtention d'or, car dans le cas d'un simple échange de marchandises, les biens ordinaires, utilisés, cessent d'exister et l'or s'accumule dans le pays et peut à nouveau être utilisé pour les échanges internationaux.
Dans ce cas, le trading était considéré comme un jeu à somme nulle, lorsque le gain d'un participant entraîne automatiquement la perte de l'autre, et vice versa. Pour obtenir le maximum d'avantages, il a été proposé de renforcer l'intervention et le contrôle du gouvernement sur l'état du commerce extérieur. La politique commerciale des mercantilistes, appelée protectionnisme, se résumait à créer des barrières au commerce international, à protéger les producteurs nationaux de la concurrence étrangère, à stimuler les exportations et à restreindre les importations en imposant des droits de douane sur les marchandises étrangères et en recevant de l'or et de l'argent en échange de leurs marchandises.
Les principales dispositions de la théorie mercantiliste du commerce international :
La nécessité de maintenir une balance commerciale active de l'État (excès des exportations sur les importations) ;
Reconnaissance des avantages d'attirer l'or et d'autres métaux précieux dans le pays afin d'augmenter son bien-être ;
La monnaie est une incitation au commerce, car on pense qu'une augmentation de la masse monétaire augmente le volume de la masse marchande ;
Le protectionnisme visant à importer des matières premières et des produits semi-finis et à exporter des produits finis est le bienvenu;
Restriction à l'exportation de produits de luxe, car elle conduit à la fuite d'or de l'État.
La théorie de l'avantage absolu d'Adam Smith.
Dans son étude sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations, Smith, dans une polémique avec des mercantilistes, a formulé l'idée que les pays sont intéressés par le libre développement du commerce international, puisqu'ils peuvent en bénéficier, qu'ils soient exportateurs ou importateurs. Chaque pays devrait se spécialiser dans la production du produit où il a un avantage absolu - un avantage basé sur le montant différent des coûts de production dans les différents pays participant au commerce extérieur. Le refus de la production de biens pour lesquels les pays ne disposent pas d'avantages absolus, et la concentration des ressources sur la production d'autres biens entraînent une augmentation des volumes totaux de production, une augmentation des échanges de produits de leur travail entre les pays.
La théorie de l'avantage absolu d'Adam Smith suggère que la richesse réelle d'un pays consiste en les biens et services disponibles pour ses citoyens. Si un pays peut produire tel ou tel produit plus et moins cher que d'autres pays, alors il a un avantage absolu. Certains pays peuvent produire des biens plus efficacement que d'autres. Les ressources du pays affluent vers les industries rentables, car le pays ne peut pas rivaliser dans les industries non rentables. Cela conduit à une augmentation de la productivité du pays ainsi que des qualifications de la main-d'œuvre ; de longues périodes de production homogène incitent à développer des méthodes de travail plus efficaces.
Avantages naturels pour un pays donné : climat ; territoire; Ressources. Les avantages acquis pour un seul pays : la technologie de production, c'est-à-dire la capacité de fabriquer une variété de produits.
La théorie de l'avantage comparatif par D. Ricardo et D.S. Moulin.
Dans son ouvrage « Principes d'économie politique et de fiscalité », Ricardo a montré que le principe de l'avantage absolu n'est qu'un cas particulier de la règle générale, et a étayé la théorie de l'avantage comparatif (relatif). Lors de l'analyse des directions de développement du commerce extérieur, deux circonstances doivent être prises en compte : d'une part, les ressources économiques - naturelles, main-d'œuvre, etc. - sont inégalement réparties entre les pays, et d'autre part, la production efficace de divers biens nécessite des technologies ou des combinaisons différentes. de ressources.
Les avantages dont disposent les pays ne sont pas des données une fois pour toutes, a fait valoir Ricardo, de sorte que même les pays ayant des niveaux de coûts de production absolument plus élevés peuvent bénéficier des échanges commerciaux. Il est dans l'intérêt de chaque pays de se spécialiser dans la production, dans laquelle il a le plus grand avantage et le moins de faiblesse, et pour laquelle le profit non absolu, mais relatif est le plus grand - c'est la loi de l'avantage comparatif de D. Ricardo.
Selon la version de Ricardo, le volume total de la production sera le plus élevé lorsque chaque produit est fabriqué par le pays dans lequel les coûts d'opportunité (imputés) sont plus faibles. Ainsi, un avantage relatif est un avantage basé sur des coûts d'opportunité (imputés) inférieurs dans le pays exportateur. Par conséquent, en raison de la spécialisation et du commerce, les deux pays participant à l'échange en bénéficieront. Un exemple dans ce cas est l'échange de drap anglais contre du vin portugais, qui profite aux deux pays, même si les coûts de production absolus du drap et du vin sont plus bas au Portugal qu'en Angleterre.
Par la suite D.S. Mill dans son ouvrage "Fondements de l'économie politique" a donné une explication du prix auquel s'effectue l'échange. Selon Mill, le prix d'échange est fixé selon les lois de l'offre et de la demande à un niveau tel que l'ensemble des exportations de chaque pays permet de payer l'ensemble de ses importations — c'est la loi de la valeur internationale.
Théorie de Heckscher-Ohlin.
Cette théorie des scientifiques suédois, apparue dans les années 30 du XXe siècle, fait référence aux concepts néoclassiques du commerce international, puisque ces économistes n'adhéraient pas à la théorie de la valeur travail, considérant le capital et la terre comme productifs, ainsi que le travail. . Par conséquent, la raison de leur commerce est la fourniture différente de facteurs de production dans les pays participant au commerce international.
Les principales dispositions de leur théorie se résumaient à ce qui suit : premièrement, les pays ont tendance à exporter les biens pour la fabrication desquels sont utilisés les facteurs de production abondants du pays et, à l'inverse, à importer des biens pour la production desquels des facteurs relativement rares sont avait besoin; deuxièmement, il y a une tendance à l'égalisation des « prix des facteurs » dans le commerce international ; troisièmement, l'exportation de marchandises peut être remplacée par le transfert de facteurs de production au-delà des frontières nationales.
Le concept néoclassique de Heckscher-Ohlin s'est avéré commode pour expliquer les raisons du développement des échanges entre pays développés et pays en développement, lorsqu'en échange de matières premières entrant dans les pays développés, des machines et équipements étaient importés dans les pays en développement. Cependant, tous les phénomènes du commerce international ne rentrent pas dans la théorie de Heckscher-Ohlin, puisqu'aujourd'hui le centre de gravité du commerce international se déplace progressivement vers le commerce mutuel de biens "similaires" entre pays "similaires".
Le paradoxe de Léontief.
Il s'agit de la recherche d'un économiste américain qui a remis en question les dispositions de la théorie Heckscher-Ohlin et a montré que dans la période d'après-guerre, l'économie américaine s'est spécialisée dans ces types de production qui nécessitaient relativement plus de travail que de capital. L'essence du paradoxe de Léontiev était que la part des biens à forte intensité de capital dans les exportations pouvait augmenter et celle à forte intensité de main-d'œuvre pouvait diminuer. En réalité, lors de l'analyse de la balance commerciale américaine, la part des biens à forte intensité de main-d'œuvre n'a pas diminué.
La solution au paradoxe de Léontiev était que l'intensité de main-d'œuvre des biens importés par les États-Unis est assez élevée, mais le prix du travail dans la valeur des marchandises est bien inférieur à celui des exportations des États-Unis. L'intensité capitalistique du travail aux États-Unis est importante, ainsi qu'une productivité du travail élevée, ce qui conduit à une influence significative du prix du travail dans les fournitures d'exportation. La part de l'offre HIMO dans les exportations américaines augmente, confirmant le paradoxe de Leontief. Ceci est dû à une augmentation de la part des services, des prix du travail et de la structure de l'économie américaine. Cela conduit à une augmentation de l'intensité de main-d'œuvre de l'ensemble de l'économie américaine, sans exclure les exportations.
La théorie du cycle de vie d'un produit.
Elle a été avancée et étayée par R. Verna, C. Kindelberger et L. Wels. Selon eux, un produit passe par un cycle de cinq étapes depuis son apparition sur le marché jusqu'à sa sortie :
Développement de produits. L'entreprise trouve et met en œuvre une nouvelle idée de produit. A cette époque, le volume des ventes est nul, les coûts augmentent.
Apporter des marchandises au marché. Il n'y a pas de profit en raison des coûts de marketing élevés, les ventes augmentent lentement ;
Conquête rapide du marché, augmentation des bénéfices ;
Maturité. La croissance des ventes ralentit car la plupart des consommateurs ont déjà été attirés. Le niveau de profit reste inchangé ou diminue en raison de l'augmentation des coûts des activités de marketing pour protéger le produit de la concurrence ;
Déclin. Une baisse des ventes et une baisse des bénéfices.
La théorie de M. Porter.
Cette théorie introduit le concept de compétitivité d'un pays. C'est la compétitivité nationale, du point de vue de Porter, qui détermine le succès ou l'échec dans des industries spécifiques et la place qu'un pays occupe dans l'économie mondiale. La compétitivité nationale est déterminée par la capacité de l'industrie. L'explication de l'avantage compétitif du pays repose sur le rôle du pays d'origine dans la stimulation du renouvellement et de l'amélioration (c'est-à-dire dans la stimulation de la production d'innovations).
Mesures gouvernementales pour maintenir la compétitivité :
L'influence du gouvernement sur les conditions des facteurs ;
Influence du gouvernement sur les conditions de la demande ;
Impact du gouvernement sur les industries connexes et de soutien ;
L'influence du gouvernement sur la stratégie, la structure et la rivalité des entreprises.
Une concurrence suffisante sur le marché intérieur est une incitation sérieuse au succès sur le marché mondial. La domination artificielle des entreprises avec l'aide de l'État, du point de vue de Porter, est une décision négative qui conduit au gaspillage et à l'utilisation inefficace des ressources. Les prémisses théoriques de M. Porter ont servi de base à l'élaboration de recommandations au niveau des États pour améliorer la compétitivité des biens du commerce extérieur en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis dans les années 90 du XXe siècle.
Le théorème de Rybchinsky. Le théorème consiste à affirmer que si la valeur de l'un des deux facteurs de production augmente, alors afin de maintenir des prix constants pour les biens et les facteurs, il est nécessaire d'augmenter la production des produits dans lesquels ce facteur accru est intensivement utilisé , et de réduire la production du reste des produits qui utilisent intensivement un facteur fixe. Pour que les prix des biens restent constants, les prix des facteurs de production doivent être constants.
Les prix des facteurs ne peuvent rester constants que si le rapport des facteurs utilisés dans les deux industries reste constant. Dans le cas d'une augmentation d'un facteur, cela ne peut avoir lieu qu'avec une augmentation de la production dans l'industrie dans laquelle ce facteur est intensivement utilisé, et une réduction de la production dans une autre industrie, ce qui conduira à la libération d'un facteur fixe qui deviendra disponible pour une utilisation avec un facteur de croissance dans une industrie en expansion. ...
La théorie de Samuelson et Stolper.
Au milieu du XXe siècle. (1948) Les économistes américains P. Samuelson et V. Stolper ont amélioré la théorie de Heckscher-Ohlin, en présentant qu'en cas d'homogénéité des facteurs de production, d'identité de technologie, de concurrence parfaite et de mobilité complète des biens, l'échange international égalise le prix des facteurs de production entre les pays. Les auteurs fondent leur concept sur le modèle Ricardo avec des ajouts de Heckscher et Ohlin et voient le commerce non seulement comme un échange mutuellement bénéfique, mais aussi comme un moyen de réduire l'écart de développement entre les pays.
Sujet : Théories classiques et modernes du commerce mondial (Option numéro 9)
Type : Travail d'essai | Taille : 23.31K | Téléchargé : 304 | Ajouté le 05/10/11 à 17:26 | Note : +10 | Plus de tests
Université : VZFEI
Année et ville : Moscou 2011
Numéro d'option 9
1. Théories classiques et modernes du commerce mondial. 3
2. Contrôle tâches de test. 15
3. Le défi. seize
Liste de la littérature utilisée .. 18
1. Théories classiques et modernes du commerce mondial
Le commerce mondial- est une forme de communication entre producteurs de pays différents, née sur la base de la division internationale du travail, et exprime leur dépendance économique mutuelle.
La première tentative d'appréhension théorique du commerce international et d'élaboration de recommandations dans ce domaine a été la doctrine du mercantilisme, qui prévalait à l'époque manufacturière, c'est-à-dire du XVIe siècle. jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. lorsque la division internationale du travail se limitait principalement aux relations bilatérales et tripartites. L'industrie de l'époque ne s'était pas encore détachée du sol national et des marchandises étaient produites pour l'exportation à partir de matières premières nationales. Ainsi, l'Angleterre a transformé la laine, l'Allemagne - le lin, la France - la soie en lin, etc. Les mercantilistes ont adhéré à l'idée que l'État devrait vendre sur le marché étranger autant de marchandises que possible et acheter le moins possible. Cela accumulera de l'or, identifié à la richesse. Il est clair que si tous les pays poursuivent une telle politique de refus d'importer, alors il n'y aura pas d'acheteurs et il ne sera plus question de commerce international.
Les théories classiques du commerce mondial
La théorie des avantages absolus d'A. Smith
Le fondateur de la science économique, Adam Smith, dans son livre "Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations" (1776) a accordé une grande attention à la division du travail sur la base de la spécialisation de l'activité économique. Dans le même temps, A. Smith a étendu les conclusions sur la division du travail à l'économie mondiale, en justifiant pour la première fois théoriquement le principe des avantages absolus (ou coûts absolus) : que de les acheter à côté... Ce qui semble être raisonnable dans le cours de l'action de n'importe quelle famille privée peut difficilement être déraisonnable pour tout le royaume. Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à un prix inférieur à celui que nous pouvons produire, il vaut bien mieux l'acheter auprès de lui avec une partie du produit de notre propre travail industriel, appliqué dans la région où nous avoir un certain avantage "
Ainsi, l'essence des vues d'A. Smith est que la base du développement du commerce international est la différence des coûts absolus. Le commerce aura un effet économique si les marchandises sont importées d'un pays où les coûts sont absolument inférieurs, et ces marchandises sont exportées dont les coûts dans ce pays sont inférieurs à ceux de l'étranger.
La théorie de l'avantage comparatif de D. Ricardo
Un autre classique, David Ricardo, a prouvé de manière convaincante que la spécialisation interétatique est bénéfique non seulement dans les cas où un pays a un avantage absolu dans la production et la commercialisation de ce produit par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire. il n'est pas nécessaire que les coûts de fabrication de ce produit soient inférieurs aux coûts de produits similaires créés à l'étranger. Il suffit, selon D. Ricardo, que ce pays exporte les biens pour lesquels il possède des avantages comparatifs, c'est-à-dire de sorte que pour ces biens le rapport de ses coûts aux coûts des autres pays lui serait plus favorable que pour les autres biens.
La théorie de l'avantage comparatif repose sur un certain nombre d'hypothèses. Il vient de la présence de deux pays et de deux biens ; les coûts de production uniquement sous forme de salaires, qui d'ailleurs sont les mêmes pour toutes les professions ; ignorer les différences de niveaux de salaires entre les pays ; l'absence de coûts de transport et la disponibilité du libre-échange. Ces premiers prérequis étaient nécessaires pour identifier les principes de base du développement du commerce international.
Théorie de la corrélation des facteurs de Heckscher-Ohlin
Le développement ultérieur de la théorie classique du commerce international est associé à la création dans les années 20. XXe siècle Les économistes suédois Eli Heckscher et Bertil Théorie d'Olin le rapport des facteurs de production. Cette théorie repose sur les mêmes prémisses que les théories de l'avantage absolu et comparatif de Smith et Ricardo. La principale différence est qu'elle procède de la présence non pas d'un, mais de deux facteurs de production : le travail et le capital. Selon les vues de Heckscher et Ohlin, chaque pays est doté de ces facteurs de production à des degrés divers, ce qui donne lieu à des différences dans le rapport des prix pour eux dans les pays participant au commerce international. Le prix du capital est le taux d'intérêt et le prix du travail est le salaire.
Le niveau des prix relatifs, c'est-à-dire le rapport des prix du capital au travail dans les pays plus riches en capital sera plus faible que dans les pays avec un déficit de capital et des ressources en main-d'œuvre relativement importantes. A l'inverse, le niveau des prix relatifs du travail et du capital dans les pays disposant de ressources en main-d'œuvre excédentaires sera plus faible que dans d'autres pays où elles sont rares.
Ceci, à son tour, conduit à une différence dans les prix relatifs des mêmes biens, dont dépendent les avantages comparatifs nationaux. Ainsi, chaque pays tend à se spécialiser dans la production de biens nécessitant plus de facteurs, dont il est relativement mieux doté.
Théorème d'égalisation des prix des facteurs (théorème de Heckscher - Ohlin - Samuelson)
Sous l'influence du commerce international, les prix relatifs des biens impliqués dans le commerce mondial tendent à s'égaliser. Cela conduit également à l'égalisation du rapport des prix des facteurs de production utilisés dans la création de ces biens dans les différents pays. La nature de cette interaction a été révélée par l'économiste américain P. Samuelson, qui partait des postulats de base de la théorie de Heckscher-Ohlin. Conformément au théorème de Heckscher-Ohlin-Samuelson, le mécanisme d'égalisation des prix des facteurs de production est le suivant. En l'absence de commerce extérieur, les prix des facteurs de production (salaires et taux d'intérêt) seront différents dans les deux pays : le prix du facteur excédentaire sera relativement plus bas, et le prix du facteur rare sera relativement plus élevé.
La participation au commerce international et la spécialisation du pays dans la production de biens à forte intensité de capital entraînent des flux de capitaux vers les industries d'exportation. La demande d'un facteur de production excédentaire dans un pays donné dépasse l'offre de ce dernier, et son prix (taux d'intérêt) augmente. Au contraire, la demande de travail, qui est un facteur rare dans un pays donné, est relativement réduite, ce qui entraîne une baisse de son prix - les salaires.
Dans un autre pays, relativement mieux doté en ressources de main-d'œuvre, la spécialisation dans la production de biens à haute intensité de main-d'œuvre entraîne des déplacements importants ressources en main-d'œuvre aux industries d'exportation respectives. Une augmentation de la demande de travail entraîne une augmentation des salaires. La demande de capital diminue relativement, ce qui entraîne une baisse de son prix - le taux d'intérêt.
Le paradoxe de Léontief
Conformément à la théorie du rapport des facteurs de production, les différences relatives dans leur dotation déterminent la structure du commerce extérieur de groupes individuels de pays. Dans les pays relativement plus saturés en capital, les biens à forte intensité de capital devraient prévaloir dans les exportations et les biens à forte intensité de main-d'œuvre dans les importations. À l'inverse, dans les pays relativement plus saturés en main-d'œuvre, les biens à forte intensité de main-d'œuvre prévaudront dans les exportations et les biens à forte intensité de capital dans les importations.
La théorie du rapport des facteurs de production a été soumise à plusieurs reprises à des tests empiriques en analysant des statistiques spécifiques pour différents pays.
L'étude la plus célèbre de ce genre a été réalisée en 1953 par le célèbre économiste américain d'origine russe V. Léontiev. Il a analysé la structure du commerce extérieur américain en 1947 et 1951.
L'économie américaine après la Seconde Guerre mondiale était caractérisée par une forte saturation du capital et des salaires relativement plus élevés par rapport à d'autres pays. Conformément à la théorie du rapport des facteurs de production, les États-Unis d'Amérique devaient exporter principalement des biens à forte intensité de capital et importer principalement des biens à forte intensité de main-d'œuvre.
V. Leontyev a déterminé le rapport entre les coûts en capital et en main-d'œuvre requis pour la production de produits d'exportation pour 1 million de dollars et le même volume d'importations en termes de valeur. Contrairement aux attentes, l'enquête a révélé que les importations américaines étaient 30 % plus capitalistiques que les exportations. Ce résultat est devenu connu sous le nom de « paradoxe de Léontief ».
Dans la littérature économique, il existe diverses explications au paradoxe de Leontief. Le plus convaincant d'entre eux est que les États-Unis, en avance sur les autres pays industrialisés, ont obtenu des avantages significatifs dans la création de nouveaux biens à forte intensité de savoir. Ainsi, dans les exportations américaines, une place importante était occupée par des biens dont les coûts de main-d'œuvre qualifiée étaient relativement élevés, tandis que les importations étaient dominées par des biens nécessitant des dépenses en capital relativement importantes, y compris divers types de matières premières.
Le paradoxe de Leontief met en garde contre une utilisation trop simple et trop simplifiée des conclusions de la théorie de Heckscher-Ohlin à des fins pratiques.
Les théories modernes du commerce international
La théorie Heckscher-Ohlin expliquait le développement du commerce extérieur par les différentes dotations des pays en facteurs de production, mais au cours des dernières décennies, les échanges entre pays ont commencé à augmenter, là où la différence de dotations en facteurs est faible, c'est-à-dire il y a une contradiction - les raisons du commerce ont disparu et le commerce a augmenté. Cela est dû au fait que la théorie Heckscher-Ohlin s'est développée dans les années où le commerce interindustriel était prédominant. Au début des années 50, le plus caractéristique était l'échange de matières premières des pays en développement contre les produits de l'industrie manufacturière des pays développés. Au début des années 80, les 2/3 des exportations, par exemple vers la Grande-Bretagne, sont allés en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Dans le commerce extérieur des pays industriellement développés, l'échange mutuel de produits manufacturés est devenu prédominant. De plus, ces pays vendent et achètent simultanément non seulement les produits de l'industrie manufacturière, mais les mêmes produits par leur nom, ne différant que par leurs caractéristiques de qualité. Une caractéristique de la production de biens d'exportation dans les pays industrialisés est le coût relativement élevé de la R&D. Ces pays se spécialisent aujourd'hui de plus en plus dans la production de produits high-tech dits à haute intensité scientifique.
Le développement des industries à forte intensité de connaissance et la croissance rapide des échanges internationaux de leurs produits ont conduit à la formation de théories de la direction néotechnologique. Cette direction est un ensemble de modèles séparés, se complétant partiellement, mais parfois se contredisant.
Théorie du fossé technologique
Conformément à cette théorie, le commerce entre pays s'effectue même avec la même dotation en facteurs de production et peut être causé par des changements techniques qui se produisent dans une industrie donnée dans l'un des pays commerçants, du fait que les innovations techniques apparaissent initialement dans un pays, ce dernier a un avantage : les nouvelles technologies permettent de produire des biens à moindre coût. Si l'innovation consiste en la production d'un nouveau produit, alors l'entrepreneur dans le pays innovant a pendant un certain temps ce qu'on appelle le "quasi-monopole", en d'autres termes, il reçoit un profit supplémentaire en exportant un nouveau produit. D'où la nouvelle stratégie optimale : produire non pas quelque chose qui est relativement moins cher, mais quelque chose que personne d'autre ne peut encore produire, mais qui est nécessaire pour tout le monde ou pour beaucoup. Dès que d'autres peuvent maîtriser cette technologie - pour produire quelque chose de nouveau et encore quelque chose qui n'est pas disponible pour les autres.
L'émergence des innovations techniques crée un « fossé technologique » entre les pays avec et sans ces innovations. Cet écart sera progressivement comblé, puisque d'autres pays commencent à copier l'innovation du pays pionnier. Cependant, jusqu'à ce que l'écart soit comblé, le commerce de nouveaux biens produits à l'aide de la nouvelle technologie se poursuivra.
Théorie du cycle de vie du produit
Au milieu des années 60. L'économiste américain R. Vernon a avancé la théorie du cycle de vie des produits, dans laquelle il a tenté d'expliquer le développement du commerce mondial des produits finis à partir des étapes de leur vie, c'est-à-dire la période pendant laquelle le produit est viable sur le marché et répond aux objectifs du vendeur.
La théorie ci-dessus est la théorie la plus populaire de la direction néotechnologique. Il a attiré presque tous les économistes, car il reflète mieux l'état réel de la division internationale du travail à l'époque moderne. Conformément à cette théorie, chaque nouveau produit passe par un cycle qui comprend les étapes d'introduction, d'expansion, de maturité et de vieillissement. Chaque étape a une demande et une technologie différentes.
Dans la première étape du cycle, il y aura peu de demande pour le produit. Il est présenté aux personnes aux revenus élevés, pour qui le prix importe peu au moment de décider d'acheter ou non un produit. Plus il y a de personnes à hauts revenus, plus il est probable que de nouveaux produits apparaissent sur le marché, dont la production nécessite des coûts élevés, car leur technologie n'a pas encore été testée. Cette technologie implique l'utilisation d'un grand nombre de travailleurs hautement qualifiés. L'exportation de nouveaux biens dans la première étape sera négligeable.
Au deuxième stade - le stade de la croissance, la demande sur le marché intérieur augmente rapidement, le produit devient généralement reconnu. La production en série de gros lots de nouveaux produits commence. A ce stade, il existe une demande pour un nouveau produit à l'étranger. Initialement, il est pleinement satisfait par l'exportation, puis la production à l'étranger du nouveau produit commence par le transfert de technologie.
Au troisième stade, la demande sur le marché intérieur est saturée. La technologie de fabrication est entièrement standardisée, permettant l'utilisation d'une main-d'œuvre moins qualifiée, des coûts de production inférieurs, des prix plus bas et une production maximale de biens par les entreprises du pays innovant et d'outre-mer. Ces derniers commencent à pénétrer le marché intérieur du pays où le produit est apparu.
A la dernière étape du cycle, le produit vieillit, sa production commence à décliner. Une nouvelle baisse des prix n'entraîne plus une augmentation de la demande, car elle était au stade de maturité.
C'est le schéma général pour qu'un nouveau produit passe son « cycle de vie ». Les théoriciens de ce modèle ne se limitent pas à de telles descriptions générales... Ils pensent qu'il est possible d'indiquer des pays spécifiques dont les conditions sont les plus compatibles avec la production, ou produits les plus récents, ou des biens à d'autres stades de maturité.
Théorie de la spécialisation en production
Au début des années 80 du XXe siècle. Les économistes américains P. Krugman et K. Lancaster ont proposé une alternative à l'explication classique des causes du commerce international. Selon leur approche, les pays à dotations factorielles égales seront en mesure de tirer le meilleur parti des échanges entre eux s'ils se spécialisent dans des économies d'échelle différentes. L'essence de cet effet, bien connu de la théorie microéconomique, est qu'avec une certaine technologie et organisation de la production, les coûts moyens à long terme diminuent à mesure que le volume de la production augmente, c'est-à-dire les économies d'échelle découlent de la production de masse.
Pour que l'effet de la production de masse se réalise, un marché suffisamment grand est évidemment nécessaire. Le commerce international y joue un rôle décisif, puisqu'il permet la formation d'un marché unique intégré, plus vaste que le marché d'un seul pays. En conséquence, plus de produits sont offerts aux consommateurs et à des prix inférieurs.
La théorie de la compétitivité internationale des nations
Dans une rangée séparée se trouve la théorie de M. Porter, qui estime que les théories de D. Ricardo et Heckscher-Ohlin ont déjà joué un rôle positif dans l'explication de la structure du commerce extérieur, mais au cours des dernières décennies, elles ont en fait perdu leur signification pratique. , puisque les conditions de formation des avantages concurrentiels ont considérablement changé, la dépendance de la compétitivité des industries à la disponibilité des principaux facteurs de production dans le pays est éliminée. M. Porter identifie les déterminants suivants qui forment l'environnement dans lequel se développent les avantages compétitifs des industries et des entreprises :
1) facteurs de production d'une certaine quantité et qualité ;
2) les conditions de la demande intérieure pour les produits de cette industrie, ses paramètres quantitatifs et qualitatifs ;
3) la présence d'industries connexes et de soutien qui sont compétitives sur le marché mondial ;
4) la stratégie et la structure des entreprises, la nature de la concurrence sur le marché intérieur.
Les déterminants nommés de l'avantage concurrentiel forment un système, se renforçant mutuellement et conditionnant le développement de chacun. À eux s'ajoutent deux autres facteurs qui peuvent sérieusement affecter la situation dans le pays : les actions gouvernementales et les événements aléatoires. Toutes les caractéristiques énumérées de l'environnement économique, dans lequel des industries compétitives peuvent être formées, sont considérées dans la dynamique, comme un système de développement flexible.
L'État joue un rôle important dans le processus de formation des avantages spécifiques des branches de l'économie nationale, bien que ce rôle soit différent pour differentes etapes ce processus. Il peut s'agir d'investissements ciblés, de promotion des exportations, de régulation directe des flux de capitaux, de protection temporaire de la production nationale et de stimulation de la concurrence dans les premiers stades ; régulation indirecte par régime fiscal, le développement des infrastructures de marché, base d'informations pour les entreprises en général, financement de la recherche, soutien les établissements d'enseignement etc. L'expérience montre que dans aucun des pays la création d'industries compétitives n'a été complète sans la participation de l'État sous une forme ou une autre. Ceci est d'autant plus vrai pour les transitions systèmes économiques car la relative faiblesse du secteur privé ne lui permet pas de constituer de manière autonome les facteurs nécessaires d'avantage concurrentiel et de se tailler une place sur le marché mondial en peu de temps.
Théorie activités de commerce extérieur entreprises
Dans cette théorie, l'objet d'analyse n'est pas un seul pays, mais une entreprise internationale. Le fondement objectif de cette approche est le fait généralement reconnu par la science économique : une part importante des opérations de commerce extérieur est en réalité un échange intra-firme : les liens intra-firme représentent actuellement environ 70 % de l'ensemble des échanges mondiaux de biens et de services, 80 -90% des licences et brevets vendus, 40% des exportations de capitaux...
Le commerce interentreprises repose sur l'échange de produits semi-finis et de pièces détachées servant à l'assemblage d'un produit destiné à être vendu sur le marché mondial. Dans le même temps, les statistiques du commerce extérieur indiquent que le commerce extérieur se développe rapidement entre les pays où se trouvent les plus grandes sociétés transnationales.
Ainsi, le développement et la complication du commerce international se sont reflétés dans l'évolution des théories expliquant les forces motrices de ce processus. V conditions modernes les différences de spécialisation internationale ne peuvent être analysées qu'à partir de l'ensemble de tous les modèles clés de la division internationale du travail.
Si l'on considère le commerce mondial sous l'angle de ses tendances de développement, il y a, d'une part, une nette augmentation de l'intégration internationale, l'effacement progressif des frontières et la création de divers blocs commerciaux interétatiques, d'autre part, l'approfondissement des la division internationale du travail, la gradation des pays en pays industrialisés et en retard.
En termes historiques, on ne peut manquer de noter l'influence croissante des pays asiatiques sur les processus du commerce mondial; il est fort probable qu'au cours du nouveau millénaire cette région jouera un rôle de premier plan dans le processus mondial de production et de vente de biens.
2. Contrôler les tâches de test
1. Indiquez les caractéristiques selon lesquelles les pays en développement appartiennent à la périphérie de l'économie mondiale :
a) spécialisation en matières premières ;
b) faible niveau de développement des forces productives ;
c) type d'économie intensive;
d) le caractère multistructuré de l'économie avec une prédominance de relations non marchandes ;
e) adaptation flexible à la situation économique mondiale.
Réponse : a), b), d).
La périphérie est principalement constituée de pays en développement. Les relations de marché dans ces pays étant faibles, le marché ne stimule pas le développement de la production, ils approvisionnent le marché mondial principalement en matières premières.
2. La principale raison de l'exode de la main-d'œuvre de Russie est :
a) les activités étrangères des STN ;
b) le bas niveau des salaires réels dans le pays ;
c) le chômage ;
d) facteur religieux.
Réponse : b).
La raison la plus importante de l'exode de la main-d'œuvre de Russie est le bas niveau des salaires. Des spécialistes de différentes professions partent dans d'autres pays pour trouver un emploi nouveau travail, afin, in fine, d'améliorer leur bien-être matériel, ce qui n'est pas facile à faire en Russie.
3. Tâche
Deux produits de même qualité - russe et américain - coûtent respectivement 300 000 roubles et 20 000 dollars. Le taux de change nominal de la devise américaine est de 24 RUB. / 1 euro. Quel est le taux de change réel ?
Solution:
La mesure générale de la compétitivité du pays en marchés internationaux sert le prix des marchandises d'un pays donné par rapport au prix d'un produit similaire dans un autre pays, en tenant compte du rapport des monnaies de ces pays. Ce ratio est appelé taux de change réel et se calcule comme suit :
Où : P - le prix du produit (ou le niveau général des prix) dans votre pays ;
Р * - le prix de la marchandise (ou le niveau général des prix) à l'étranger ;
e est le taux de change nominal ;
est le taux de change réel.
ε = 1 / 24dollar / roubles * 300 000 / 20 000 = 0,625
C'est-à-dire que le prix d'un produit russe est de 0,625 dollar américain. Autrement dit, toutes choses étant égales par ailleurs, nous pouvons échanger 6 unités de produits russes contre 1 unité de produits américains.
Réponse : Le taux de change réel est de 0,625
Liste de la littérature utilisée
- Kudrov V.M., Économie mondiale : manuel. - M. : Yustitsinform, 2009 - 512 p.
- Malkov I. V. L'économie mondiale en questions et réponses : manuel. allocation. - M. : Perspective, 2004.-- 271 p.
- Polyak GB, Markova AN Histoire de l'économie mondiale : manuel. Pour les étudiants universitaires. - 3e éd. - M. : UNITI-DANA, 2008 .-- 670 p. Faites le nous savoir.
Populaire
- Affacturage avec et sans recours
- Marge société de leasing Rentabilité des opérations de leasing
- Agriculture des régions de Russie
- Description de l'entreprise "Kazanorgsintez" Caractéristiques générales de l'entreprise de JSC "Kazanorgsintez"
- Aem technologies atommash. Branche de Volgodonsk. Les gens de la nouvelle vague
- Denis Kovalevich, Technospark : Nous n'avons pas besoin de génies des affaires, mais de gens ordinaires qui sont prêts à s'engager dans un travail entrepreneurial.
- Alexander Shiryaev : TMK s'appuie sur des produits haut de gamme et des services pétroliers et gaziers Alexander Shiryaev, Président du Directoire de TMK
- Chiffres clés de l'entreprise
- Anton Borisevich : « Nous comprenons comment l'économie des compagnies de passagers de banlieue évolue sous la charge de location. Quels sont vos projets pour l'été ?
- Faire des affaires dans une autre région Si l'entreprise exerce ses activités dans une autre région